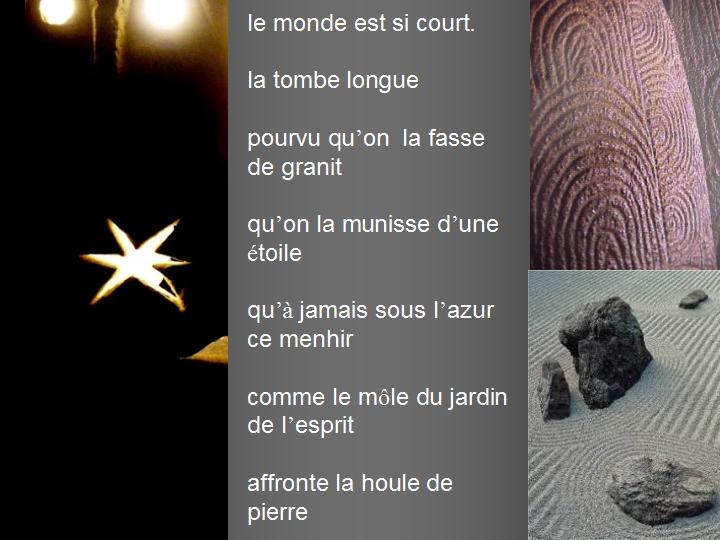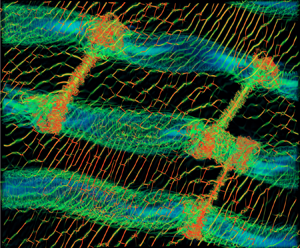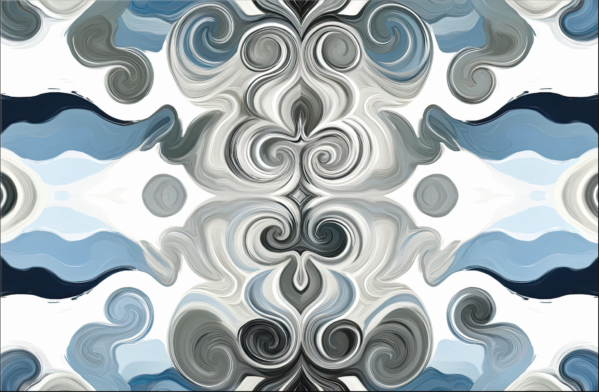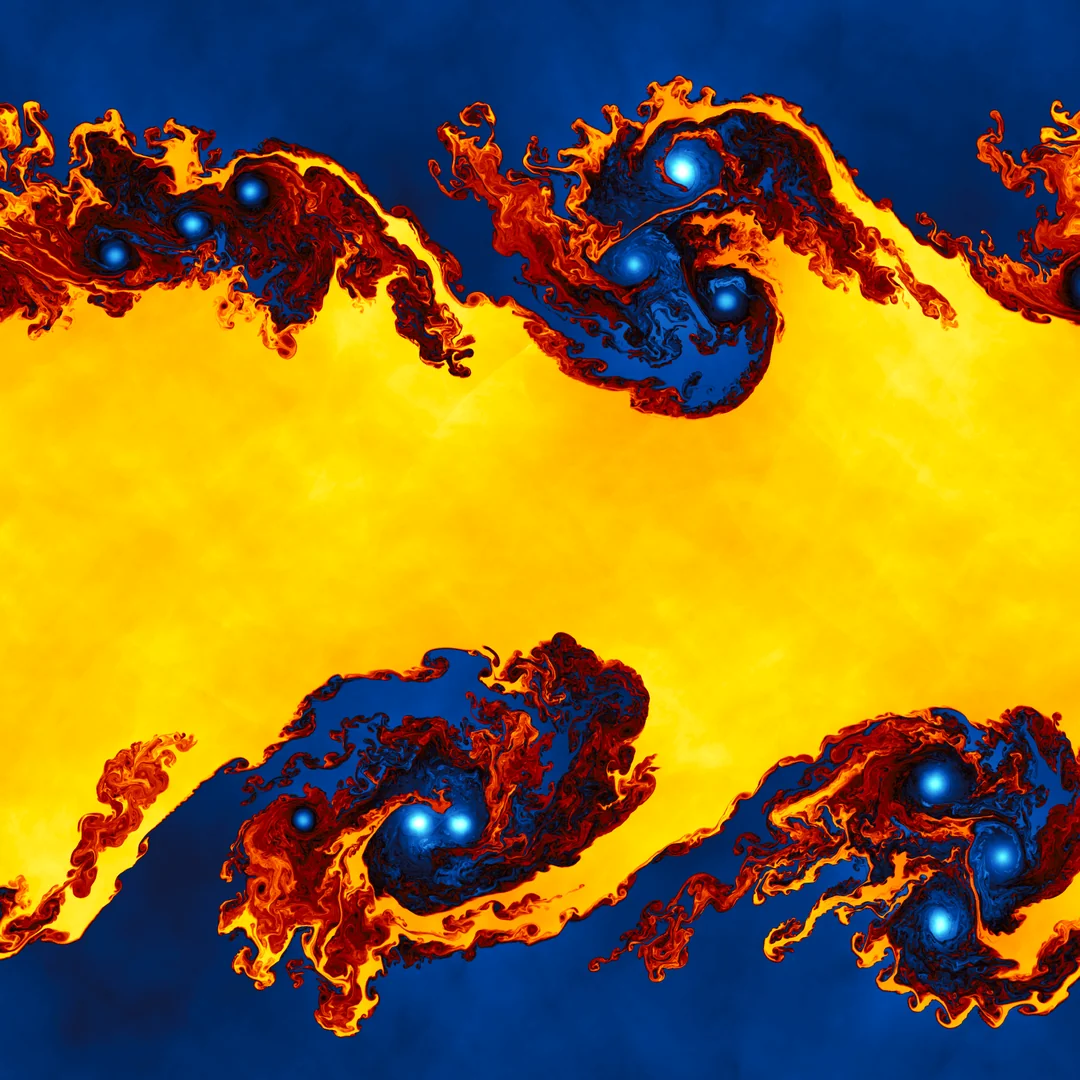In extenso
la mer des signes
Ta grand-mère la pythonisse !
Lentement l’encre nocturne remplace l’azur. Sous la lune qui prend la veille, le marbre luit, poli du frottement des étoffes. En contrebas, sur l’hémicycle, quelques lampes à huile vacillent et dans l’obscurité qui épaissit, projettent dans l’agora des ombres géantes. Les plus grands orateurs ont défilé sous ces sphères, des étrangers célèbres, des devins, des mages, des hyperboréens velus et des Noirs crépus, des Egyptiens, des marchands, des espions et même quelques gymnosophistes venus à grands périls d’au-delà des déserts sur le dos de chameaux à deux bosses.
– « Est raisonnable le raisonnement bien conformé sans schisme logique, qui décrit le réel », clame l’ombre géante d’un index, celui d’un homme peut-être trentenaire aux maxillaires carrés, nets, bien rasé, une fibule d’or à l’épaule. « Les chevaux borgnes ne sont pas chers, mais Athènes pour faire la guerre achète les plus belles cabales. Oui, la logique philosophique, voilà la supériorité d’Athènes… »
– « Tu l’as déjà dit, jeune homme », coupe un vieillard. « Qui confondrait une haridelle et un destrier ? Qui serait sot assez, même sans connaître les signes, pour échanger son or contre une haquenée borgne ? Même pas tes pères, beau jeune homme. Je les ai bien connus. Quand ils avaient leurs jambes, pour vaincre ou rester vivants, ils s’élançaient comme fous derrière l’égide. Comme leurs pères avant eux, ils rejoignaient les montagnes assister aux mystères. Les dieux les chevauchaient comme les autres. Autour de la faille omphalique, tes pères bien mieux que toi comprenaient l’importance de nos cérémonies, quand nous jouions, ensemble, tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, la comédie et le drame de nos vies. N’est-ce pas d’une femme Scythe, il y bien des générations de cela, que provient ton germon ? N’est-ce pas de l’un des Argonautes qu’elle enfanta tes pères ? Elle était parente de Médée, initiée aux cérémonies des hyperboréens, aux mystères qui se jouent sous le dôme enterré dans les vapeurs d’herbe et les effluves du sol ? Ses filles, tes aïeules, n’ont-elle pas visité les mages de Perse, les prêtres d’Egypte ? N’avait-elle pas recueilli les chants des Garamantes, les murmures de Cassiopée, les poèmes de Saba, et ouï dire des hommes singes velus de l’Afrique chevelue ? Ta grand-mère elle-même, jeune homme bien rasé, ne vivait-elle pas dans les grottes de karst, en compagnie des sangliers, dans les collines du Nord où vivaient jadis les Cyclopes, où sont encore vivants les vieux cultes ? N’était-elle pas partie longtemps vers l’Est, au-delà du pays des mages, là où les ascètes adorent un dieu aux mille bras et au collier de crânes ? Ne parlait-elle pas de ces royaumes lointains baignés à ces rivages d’où sort Apollon sur son char, consumés d’interminables guerres dont nous ne savons rien ? On m’a dit qu’une grande couleuvre mâle partageait même son antre. Ta grand-mère, beau philosophe, n’était-elle pas pythonisse ? »
La raison contre les mythes
– « Superstition, tyrannies des mythes ! Nous, philosophes, luttons pour dégager l’entendement de la gangue ancienne de la magie, des cosmogonies archaïques, des royautés enracinées dans le despotisme des mystères. La déduction qu’on fait sur l’hypothèse qu’on avance et que le réel confirme : voilà le credo. Sinon quoi ? Sinon l’émotion, la folie passagère, le démagogue qui flatte la foule, qui l’excite, qui l’enflamme, la lance par la ville forcer les portes des greniers et allumer des feux ? Ou bien préfères-tu, vieil homme, l’archaïque carcan des antiennes magiques, le vieil ordre croulant où vous les chamanes et les rois, vous entendiez si bien pour corseter l’univers et l’homme ?»
– « Les Athéniens en veulent toujours plus », tonitrue une voix forte résonnant d’accents d’airain et de marteau. « Ils ont raison d’être gourmands et ambitieux. Pourquoi ? Parce qu’ils sont raisonnables. Oui, la raison fait la grandeur d’Athènes. La raison est le fondement de sa supériorité politique et morale. Elle l’autorise à revendiquer l’hegemon sur les autres cités. Périclès les fédère pour leur bien. Elles doivent comprendre la beauté, la bonté et le juste d’Athènes.»
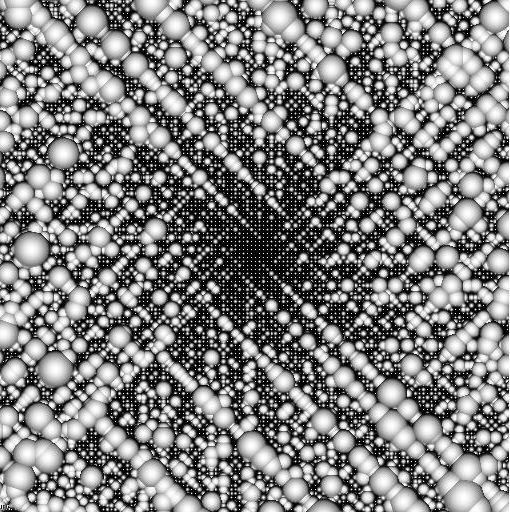
– « Elle est belle ta raison. Elle est belle la démocratie », gouaille d’au-delà la margelle, depuis l’ombre violine une voix au fort accent rempli de borborygmes. « Périclès l’a imposée aux cités fédérées, comme une punition. La démocratie ou l’invasion, la démocratie ou les camps militaires aux portes de la cité ! Périclès a trahi. Le monde nouveau que tu décris est celui d’un début trahi. Mais, je te l’accorde : ce siècle est une première expérience où tout est déjà en germe.»
– « Tant d’hommes de talent rassemblés à Athènes, en si peu de temps, sur si peu d’espace ! » s’emporte un jeune homme maigre à la toge douteuse, à la tignasse de nattes formant masse sous le bonnet de maille. « Est-ce leur génie ? Ou n’est-ce que l’occasion ? Quand la paix règne, quand l’or et l’argent circulent, le plus stupide des colporteurs remplit sa bourse. Génies de pacotille, talents d’occasion, talents factices, talents à la mode ! »
– «Talents sonnants et trébuchants, pour ça oui ! » coupe un homme depuis l’ombre. « Parlons-en des élites ! Socrate, Platon, Aristote, Périclès, Hérodote, Alexandre ? Tous cul et chemise. La même bande. Quelle autre raison plus grande a donc bien ta raison, ô beau philosophe rasé, sinon que de servir les puissants ?»
logique du conte, logique du compte
– « Votre raison », reprend le jeune homme maigre à la tignasse filasse, « c’est la logique du fer : la loi, la norme, la règle, celle que vous gravez à toutes les stèles de pierre plantées aux carrefours. Et même vous l’avez fondue dans le bronze ! Nos pères, les pères de nos pères, préféraient à vos lois la souplesse de la parole, l’accord, l’harmonie.»
– « Ne vois-tu pas que le monde a changé ? » rétorque index encoléré le philosophe aux maxillaires carrés. « Comment les vieilles coutumes pourraient-elles encore répondre aux défis d’aujourd’hui ? Jadis, toi vieillard que mes pères ont connu, tu prenais une barque, tu tournais le cap : les lois avaient changé, les temples abritaient d’autres dieux. C’était il y a longtemps. Les vaisseaux pansus, que protègent nos trirèmes, aujourd’hui nous mènent en quelques jours à Sidon, Tyr, Memphis, Cyrène, Syracuse, à Agathé Tyché ou Massa. Depuis, d’autres dieux ont rejoint dans le temple l’idole poliade. D’hors les murs ont afflué les métèques, les esclaves, les miséreux des collines et des plateaux trop arides, trop peuplés. La puissante Perse menace. Aristote peut bien conseiller l’autarcie. Si Athènes ne s’était pas tournée vers la mer, si Périclès n’avait pas imposé notre démocratie, nous échangerions encore nos sardines sèches contre l’orge plein de cailloux de Lacédémone !»
– « Vous chamanes, chenus ou jeunes, prétendus philosophes et véritables errants, n’êtes qu’une bande d’idéalistes, de rêveurs. Je construis des galères au Pyrhée. Je travaille dur, moi. Je fais commerce avec ceux du Pont. J’ai même, en ce moment peut-être, un navire au-delà des piliers d’Héraclès, parti chercher l’étain. J’importe le blé de Colchide, que vous mangez ici. Le pain de froment, vous en voulez bien, hein ? Mais vous ne voulez pas des règles, des sceaux, des mesures, des étalons pour l’acheter ! Comment sans eux fonctionnerait le commerce, sans des règles reconnues partout et par tous les marchands? Finies les disputes, les comptes et les cargaisons au jugé. Les lois faites sous le sceau de la raison sont bonnes pour le commerce. Athènes a écrit les paroles exactes. Tant mieux pour nous que ce soit elle qui l’ait fait ! »

– « Le sceau de la raison ? » rugit l’homme de l’ombre. « De raison, tu as la bouche pleine, et les bras chargés de plans de machines, de roues à dent, de cages d’écureuil, de poulies, de moufles, de bigues, de chèvres. Tu penses comme un calame, et non pas comme un homme. La belle mécanique ! Les portefaix par centaines que tu as débauchés, mourant de faim au bord des routes, entassés aux faubourgs dans des dolia crevées. Tu préfères tes engrenages aux travailleurs libres ! Même les esclaves pour toi mangent trop encore. Les engrenages ne mangent pas, ne se plaignent pas, ne réclament pas. Ta logique est celle du livre de compte. La voilà ta raison. La raison de ta raison. Ta mécanique est l’outil des patriciens, des trafiquants au grand large, l’outil du pouvoir de ta classe ! »
– « Les engrenages », renchérit le chamane à la tignasse, « conviennent bien aux machines. Mais comment pourraient-ils nous dire pourquoi reviennent les jours, les saisons, les moissons ? Vos articulations logiques sont souples comme les maillons d’une chaîne. Vos mètres et vos péroraisons de parchemin sont cassantes et rigides: on croirait l’insecte, et ses segments de chitine, pliant à peine aux joints. Notre mètre n’a besoin ni de calame, ni de stylet, ni de parchemin : il est en nous. Python seul a la souplesse nécessaire de dire au cœur des hommes les paroles qui cernent le futur. Platon même, quand il est au bout de ses raisons, revient au savoir bien usé, bien sûr, bien mûr des mages, seuls capables de faire leur part aux mystères. En peu de mots leurs bouches disent les mythes dont des mers de signes n’effleurent pas même le sens. Socrate raisonne et n’écrit pas : ses convives banquètent. La nourriture entre par la bouche des convives et la sagesse en sort. Comment pourras-tu jamais démontrer comment les enfants aiment leurs parents ? Crois-tu qu’on peut apprendre dans les livres ce que l’on est soi-même ? Crois-tu que les masques au théâtre, tout à l’heure, ici même, ne raconteront pas nos mystères bien mieux que, le licol sur la nuque, les scribes des rois, leurs nobles, leurs philosophes, leurs régisseurs, leurs marchands, leurs esclaves affranchis ? »
Parler est barbare
– « Tu insultes le savoir, sophiste ! », raille le philosophe carré de la mâchoire. « Tu insultes la science, toi qui la vends, contre argent, comme des carottes, à des marchands grossiers qui n’ont que leurs drachmes à la bouche, celui qu’ils dépensent pour ta rétribution, celui que leurs enfants gagneront grâce à ton verbe maquignon. Avocat parfois, précepteur de gosses de parvenus tantôt, secrétaire ici, rédacteur là, traducteur parfois, au gré de tes embauches : un colporteur n’est pas un philosophe. Oui, l’écriture est le savoir des rois. Oui, ses régisseurs gèrent ses domaines. Oui ses scribes notent l’or, l’argent, les pierres, les trophées, la richesse des citoyens, les contributions des alliés à la beauté d’Athènes. Oui la raison sert les rois, le mérite, la valeur, le beau. Oui, le fort est le maître de la raison ! » »
– « Ta raison te trompe », rétorque l’homme à la toge douteuse, « car si à quelque question qu’on pose, l’univers répondait par l’affirmative ? Se ferait-il que l’on puisse trouver quelque preuve à n’importe quelle conjecture ? Parce que l’étendue limitée des conjectures, infiniment inappropriées à leur objet, fait que toujours existe quelque partie du vrai qui les confirme ? »
– « La parole » continue le vieillard, « n’est pas une loi qu’on grave dans la pierre. Elle est utile. Elle se décide. Elle se plie, elle s’adapte. Nos ancêtres la façonnaient à l’ombre de l’olivier millénaire, martelée longuement comme le forgeron la lame de bronze. Longs conciliabules et braves péroraisons. Et quand les gorges s’asséchaient, quand le souffle collectif chancelait, les aèdes pour le réanimer entonnaient encore les généalogies, les exploits des héros, les épopées anciennes. Sous le dôme à demi-enterré, on racontait les rêves, les angoisses, la torsion des viscères, la peur des esprits et des sorts que jettent les envieux. Alors quelqu’un s’écriait : toi là-bas, pourquoi m’en veux-tu ? Une voix entonnait le chant des symboles qui pansent. La voix partagée soignait les griefs, la colère, l’envie, les jalousies, les complots, les maladies du corps, les maladies de l’esprit enfermé dans le corps, et celles de l’esprit qui contient tous les corps. Toi qui respectes le théâtre qu’on va jouer bientôt ici, ce soir, au milieu de ces bancs, ne sais-tu pas que ses racines puisent au vieux culte ? Ne sais-tu pas que la raison est bien faible pour soigner les maux qui n’ont pas de nom !
– « Les charlatans… », reprend après une pause le vieillard d’une voix assombrie, « les charlatans vendent des potions dont l’efficace réside dans le secret jaloux de leur fabrication et le monopole de leur distribution. Les vrais thérapeutes – leur peau sent la chèvre et non le baume – soignent l’homme en entier. Ils soignent par la parole pour ce qu’on veut bien leur donner. Seule l’évocation, la parole, la musique, l’image vivante, recèlent l’efficace. »
– « Socrate n’a jamais écrit une ligne, sauf pour la liste des courses qu’il donnait à faire à ses esclaves », persifle une voix depuis l’ombre ceignant l’amphithéâtre.
– « Platon lui-même » continue le philosophe filasse à la toge crasseuse, « hésite à confier pleinement au calame les paroles du maître, comme si l’instrument ne suffisait pas à contenir sa pensée. L’élève a ouvert les bondes. Après lui, nous le sentons bien, les scribes le diront sans plus de retenue : parler est barbare. »
Parole d’air, parole de pierre
– « Mon jeune ami a raison », s’anime le patriarche. « Les scribes n’aiment pas la parole au vol ailé. Ils n’aiment pas l’agora. Ils n’aiment pas les mots qui vont du pair au pair. Ils les veulent serrés, scellés, dans des bibliothèques, indexés, conservés, surveillés, bien gardés. Ils veulent la langue fossile, figée, servile. Bientôt leurs signes deviendront la nourriture unique de l’idée.»
– « Vieux chamane, qui connut mes aïeux, ne comprends-tu pas que les signes de Platon voyagent bien plus loin dans l’histoire, sur les mers et les routes, que les discours qui fuient avec la brise du temps et meurent avec les bouches ? Platon, Aristote surtout, défendent le privilège de la raison d’édifier l’ultime savoir, comme moellon après moellon on érige la muraille. Ecrire, c’est poser. Et sur cette première pierre construire. Bâtir, édifier, plus haut, toujours plus haut, et gagner en puissance. Le papyrus et le calame sont les outils de la raison. Un jour, grâce à eux, ratio et être s’identifieront. Pourquoi refuser de vivre avec ton temps, pourquoi refuser le progrès ? Veux-tu t’en retourner dans la caverne des pythonisses, Vieillard ? »
– « La caverne des Pythonisses est à l’abri de la foudre de Zeus, jeune homme dont j’ai connu le géniteur. L’homme bientôt ploiera sous le joug de sa propre raison. Après Platon, après Aristote, j’en suis sûr, viendra la longue théorie des demi-dieux, des demi-philosophes, des prophètes borgnes, qui diront que l’homme peut égaler le démiurge. Un jour viendra où l’homme se croira l’héritier raisonnable de dieu. Il se croira le maître du drame, quand il ne sera plus au théâtre des simulacres que la marionnette de sa nature. Je te le dis, jeune homme bien rasé: le savoir des scribes n’est qu’un voile de plus sur le visage du vrai. Oui, je le crains, le monde pivote aujourd’hui entre la parole d’air et la parole de pierre.
Certains n’ont que celle-là. Les paroles des modestes, de ceux-là, là haut, assis en dehors du cercle, leurs paroles s’envolent et comptent peu. Les autres font venir de Corinthe des blocs de marbre pour y graver leurs mots et en faire des lois. Ils font de l’agora l’annexe de leurs bibliothèques. La justice de l’olivier n’a besoin que de bouches, non pas de sceaux, non pas d’annales, non pas d’archives, non pas de coffres, non pas de scribes, non pas de secrétaires. Entre les chants des aèdes et les bibliothèques des riches, entre la parole et le stylet, entre la science des signes et le savoir des hommes, oui, le monde pivote comme ces étoiles au-dessus de nos têtes. Ton écriture, philosophe, bâillonnera trop longtemps la bouche des vivants. Vous vous trompez, nobles jeunes gens entogés. Votre jeune savoir n’est que jeune, non pas universel !
Combien de temps fera-t-il illusion : quarante, cent générations ? Les illusions de la raison ne sont pas éternelles. Sous l’écorce de l’arbre, non, l’alliance n’est pas rompue. La césure n’est pas définitive. Sous la croûte, le vieux monde des contes, des palabres, des métaphores qui aident à vivre grouille, vivace. Mais quand les mains des hommes seront brûlées, leurs papyrus réduits en cendre, c’est avec leurs gorges, leurs sanglots, leurs cris, leurs soupirs, leurs murmures, leurs caresses, qu’ils se réconforteront, se reconnaîtront, et décideront, sur l’agora, de leur destin nouveau. Car voilà maintenant ma question : comment déchirer les voiles dont vous recouvrez l’être ? »

Marco Polo est un escroc
Marco Polo est un escroc. L’escroc est libre. Il ne sert aucun maître. Ce maître qui n’est le plus souvent qu’un autre escroc. Il persuade les autres que leur bien est le sien, son bien le leur. S’il escroque l’élite, l’escroc est de talent. Cela se voit souvent. Question d’expérience et de temps : au fond la même chose. Mais aussi, il sait beaucoup de choses sans les avoir apprises : une seule pensée, une seule fulgurance sans instant, germinale, souvent suffit. Deux présents courent parallèles, chacun dotés d’un passé, d’un futur. Ils sont là par éclipses, bien que jamais absents. Temps bâtard et solipsiste, comme un décalage horaire qui n’en finit jamais. Présents croisés d’expérience où le temps subit un intime pincement. Quelles valeurs ont la durée, l’histoire, les fins, l’origine, le progrès, quand le temps vacille ? Entre les quatre murs de sa geôle génoise, entre les quatre même murs, jour après jour, à son compagnon d’infortune, Marco Polo relate ses pérégrinations. Tout le temps se joue là. Quelles collisions d’images dans l’espace mental clos de cette geôle !
Les paroles de Marco évoquaient tant de couleurs, de formes, d’émotions, de lieux, de langues : souvenir du départ, de la lagune brillant immobile, plaqué en transparence sur le spectacle, anxieux incongru, du retour. Marco Polo et Venise avaient pris vingt ans. Venise ne brillait plus de la naïveté de la jeunesse. Les femmes avaient vieilli. Dissipé, le halo d’idéal dont l’avait parée l’exil. Où est Venise ? Maintenant ? Il y a vingt ans ? Qui dit plus vrai sur Venise ? Les souvenirs de Marco ? Ceux de qui n’ont jamais quitté la lagune ? Quelle absence a le plus de sens ? Le présent a sauté d’un rayon. L’un est ici vivant, l’autre, en contre-bas de la mémoire, perdure. Le doute s’instille. Il bave comme l’encre sur le buvard. Il contamine bientôt, tout le présent et les segments de la vie désarticulée, présentent la transparence de leur flanc. Alors le monde ne fournit plus de si nettes évidences. Les a priori sédentaires font grincer l’oreille et souffrir. Non le scribe ne peut pas comprendre cette faille, le cisaillement intime du temps. El Million est l’histoire d’une faillite.
Etrange étrangeté, la durée comme au travers d’une vitre, double reflet face à face dans l’épaisseur invisible du verre. Marco, le front plombé, soupèse ce double présent indécis. Appartenance confuse entre ici et ailleurs, aujourd’hui et hier. Je contemple les hommes et les femmes autour de moi. Je ne suis pas sûr de ce que je vois. Leurs vêtements sont des peaux, les murs une paroi. Je ne vois pas mes yeux. Il n’y a plus de vitre. La figure de mes proches, quelle est-elle ? Au moins ce qui pense pense. Cela pense. Par facilité lexicale, dire « Je » pense. Penser ? Qui pense ? « Cela » pensait Marco bien plus Marco ne pensait « cela ». « Je » : est-ce cette indécision ? Rien d’autre, peut-être que le spectacle de moi à moi, de moi pour moi, de moi par moi. Où est moi ? Marco déraisonnait. « Marco, pourquoi est-tu parti ? ». Il faut toujours se justifier. Pourquoi partir en effet ? De quel nœud part-on ? Pourquoi moi ? Suis-je fou ou est-ce le monde ? « Je » ne crois pas à ce moi fragmenté. « Ma » solitude est une illusion, un défaut de raison. Les autres m’assaillent et me sustentent. Je ne peux les prouver, mais je les sens, et c’est tout différent.
Le temps de Marco, qu’on y songe, est extraordinaire. Il ne prit pas l’avion, mais chemina de longs mois à pied, à cheval, à dos de chameau, vogua sur le bois des esquifs. Il traversa d’admirables contrées et des déserts arides avant d’atteindre la Chine où il resta longtemps. Enfin Marco revint par les mêmes lents moyens. Il partit adolescent, revint homme mûr. De quelle Chine Marco parlait-il à son compagnon de cellule ? De quel Occident ? De quels présents, de quels passés, de quelles transitions sur les pistes de la soie ? La vie est également courte pour tous les hommes, à peu près. Parenthèse sans retour pour remplir le temps de sens, et dans ce bref intermède, faire face à la totalité. Durée ridicule, entendement débile, étique équité, mais le seul savoir utile, poétique. Le monde est plein de fausses connaissances qui nous distraient du sens et du loisir de poser les seules questions qui vaillent : le bien vivre, le gai savoir, la douleur, la pérennité, la liberté. Le doute ne connaît plus de barrières. Marco, agité, secoue sa tignasse comme le chamane l’égide. Oh, débusquer le cœur de fer du temps ! Juger d’un point haut, long, très long. Déceler dans l’instant les contingences de la durée, ses récurrences, ses similitudes, ses solutions, ses fractures. Temps des montagnes, temps des continents, temps des crues, des rives qui s’embourbent et des îles de sable qui fondent dans le courant. Temps des arbres, des couvées, des gésines. Temps du marchand, de la serpe et du faix. Rythmes, tempo, scansion, nœuds, pendules, cordes, vibrations, périodes, coïncidences : quelle est la géométrie du temps ?
ricochet

Ris cocher
laugh coach !
pauvre cloche sous le clocher
battant à gros bourdon
gueule de toutes tes dents
gâteuses
personne ne t’entend !
Ris gueux rugueux
rogue manant
goguenard tel Diogène
au seuil de son dolium
la queue entre les mains
gratifiant le bourgeois
de grasses grivoiseries
et de jurons les démagogues
qui le craignent plus
que Gog et Magog !
Ris cocher !
sans soin au cuir
sentant le suint et la sueur,
l’ail et le sel
guinche
grand gueux gauche
avec les garces aguichantes.
Ris, mâle cocher,
ébroue tes chicots,
chante, gueule, bois,
mange, danse, gaudriole,
fais claquer ta chicotte,
mais crains la chtouille
asticot !
Las,
loin de ta trique
ton coche, qui n’est pas d’eau
glisse à la baye,
avec les chevaux !
« Des cachalots ? »
Tu es saoule, pauvre cloche !
Casse ton verre, pas ta pipe,
vire, ripe, ricoche !
misère de la gauche
Tout animé du rêve prométhéen de changer l’homme, de le déconstruire méthodiquement pour le libérer de tous les déterminismes qui l’enchaînent, physiques, matériels, sociaux, cognitifs, pour effacer le passé et sur une page blanche tracer le grand dessein de l’émancipation universelle, le marxisme aura réussi un programme exactement inverse : détruire la société, l’atomiser, la pulvériser, la réduire à une collection d’égoïsmes qu’aucun ciment ne tient plus ensemble. Ainsi la gauche aura-t-elle réalisé le programme libertarien extrême que promouvaient Ayn Rand, Margaret Thatcher, Ludwig Von Mises, Friedrich Hayek et aujourd’hui Javier Milei ou Donald Trump.
Fondé sur la solidarité des classes exploitées et l’idée que l’homme n’est rien sans son inscription sociale, qu’il est l’un des lieux d’un continuum plus grand que lui – la société, l’espèce – le socialisme aura en cours de route perdu tout orient pour dériver dans la direction opposée et se ranger aux intérêts d’une classe dominante convaincue que la singularité individuelle constitue un apex métaphysique, classe qui par ailleurs a intérêt à la désagrégation sociale.
Et c’est bien ce que l’analyse des composantes démographiques de la gauche montre, seulement peuplée d’universitaires, d’énarques, d’industriels, de fonctionnaires, de privilégiés. Dans ces conditions, voyant bien qu’elle n’est nullement représentée, mais au contraire méprisée, que ses intérêts économiques objectifs sont foulés au pied – zones à faibles émissions, portiques de taxation des véhicules, immigration illégale constituant une atteinte directe aux intérêts économiques des classes les plus modestes – alors nulle suprise que la plèbe se tourne vers les sirènes menteuses de l’extrême droite. Il plaît au bloc bourgeois de penser qu’Hitler parvint au pouvoir en raison de l’imbécillité des masses. Mais qui avait rédigé les clauses léonines du Traité de Versailles qui conduit plusieurs décennies plus tard à la misère populaire ? L’exacte même chose se déroule aujourd’hui. La misère populaire jette la populace dans des bras fanatiques, mais les raisons pour lesquelles elle le fait appartiennent entièrement aux élites bourgeoises auxquelles collent encore, par simple rémanence, l’étiquette de gauche
Galactique de Gaïa

tectonique culinaire et gastro-astronomique !
Il y a quelques décennies des géologues un poil farfelus prétendaient que les sols du fossé rhodanien seraient constitués de calcaire urgonien. Et pourquoi pas de 豆腐 – dòufu-tofu?
Remettons les choses à l’endroit : côté Drôme, le picodon fossile forme l’essentiel des terrains (plus quelques filons de caillette indurée). Côté Ardèche domine le pélardon métamorphique. Or – la géochimie le démontre – ces deux lèvres du fossé rhodanien étaient jadis cousues en un ensemble unique. Moraines, banquettes de galets, couches de sable, lits d’argile, bancs de loess, tables de tuf, strates de brèche, furent jadis arrachés au substrat galactique commun d’archéo picolardon – ainsi les spécialistes nomment-ils la roche-mère [1] – par d’antiques fleuves de lait et des bises mugissantes. Ce qui jadis se tenait comme un bloc, le roulement plutonien des magmas le déchira comme on ouvre une braguette.
Chacune sur sa rive, l’Ardèche du pélardon et la Drôme du picodon entamèrent leurs croisières séparées sur les bouillons rougeoyants du magma avant de sombrer dans les entrailles ignées où Hadès les guette. Flottant sur la pâte torride encore l’instant de quelques millénaires, ces fragiles éponges de croûte fromagère font comme ces mousses d’ombre filant fugaces au cul brillant des coulées d’or vomies par les gueulards des haut-fourneaux . Dérive inexorable ! Depuis ces temps lointains, la faille s’est ouverte. Elle court désormais de la Croix Rousse au Panier, du marché des Lices à l’amphithéâtre des Gaule.
Non seulement le rift cisailla-t-il le Gondwana, encore sépara-t-il un peuple jadis unis autour d’un même fromage: le picolardon. Son culte se perdit et se dissous l’unité fromagère, désormais Voconces à l’Est et Helviens à l’Ouest, chacun avec son fromage totem, issu selon des mythes communs d’un ancêtre commun. En témoignent rien moins que César, Hannibal, Strabon, Pline, Tacite, et tant de Celtes, et d’autres avant, aux voix perdues.
Telles sont les conclusions infrangibles encore toute provisoires, d’une science nouvelle affranchie de la lentille réductionniste, munie au contraire d’une loupe magnifiante, intégrative, reliante, concernante, connectivante, inclusive, euphorique sans excès de disphorie, positivement édéitique en ménageant l’onirisme – il est vrai parfois malaisante mais à coup sûr post néo-archéo-moderne : l’anthropologie culturelle géo-gastro-astronomique !

Au nombre des résultats prometteurs de cette discipline novatrice, on a pu déterminer que les substances d’une même couleur blanc-beurré: pélardon, picodon, tofu, camembert, munster, maroilles, Pont-l’Évêque, époisse, beurre, etc – partagent toutes une cinétique physico-galactique comparable. A l’exclusion du tofu ! Le sous sol rhodanien N’EST PAS constitué de 豆腐 – dòufu-tofu ! C’est un mythe. Nous en apporterons la preuve.
L’inspiration principale de cette discipline novatrice, on la doit à Evariste Gallois, génial mathématicien hélas mort trop jeune en duel à vingt ans pour l’amour d’une belle: les propriétés d’un objet mathématique dit-il, se projettent sur un autre pourvu que tous deux soient dotés d’une même structure. Ainsi les résultats acquis dans l’étude des archéo-fromages d’Extrême-Occident sont transférables aux archéo-tofu d’Extrême-Orient – moyennant quelque assaisonnement – si l’on peut montrer que les paléo -cratons possèdent la même structure gastro-géologique. Or c’est bien le cas. La démonstration détaillée serait trop longue ici. Reste qu’archéo-fromages et archéo-tofus forment un groupe de symétrie. Etudier les uns, c’est étudier les autres
Aussi importe-t-il, pour rendre compte avec exactitude de l’évolution des confins continentaux, de bien comprendre comment aujourd’hui se cuisine le tofu d’autrefois. Le passé éclaire le présent et inversement. Ainsi la seule Chine propose une époustouflante profusion de préparations à base de soja, ancrée dans le kaléidoscope des particularismes aux dangereuses pulvérulences de la dissolution si revenaient les temps des Printemps et Automnes ou la mandragore des Seigneurs de la guerre. De cette profuse palette, les meilleures épiceries asiatiques de France ne proposent qu’une sélection étique, de sorte que le gastro-chercheur ne saurait faire l’économie d’une enquête de terrain.

Entreprenons-en ensemble les prémices. Il existe dans l’Orient global des milliers de manières de préparer le tofu. Très frais, il ressemble à du fromage blanc. Préparé avec de la ciboulette – 细香葱 xì xiāng cōng – un trait de sauce de soja, quelques gouttes d’huile de sésame noir, il fait penser à la cervelle de Canut. Egoutté, il passe par le fondant, le soyeux, le granité. On peut le frire, le mariner. Séché, fumé ou aromatisé, il prend sous la dent la consistance du fromage ou de la viande. C’est encore le 五香豆腐 – wǔxiāng dòufu – aux cinq parfums, ferme sous la dent, à la chaude couleur basane. On trouve également du vermicelle de tofu, de la peau de tofu – 豆腐皮- dòufu pí – qui ressemble à celle que formait jadis dans la casserole le lait cru. Séchée, elle devient cassante, et s’amollit dans la fondue de Chengdu, servie dans une marmite Yin-Yang à deux compartiments 鸳鸯火锅 – yinyāng huǒguō- l’un rouge et relevé, l’autre pâle et doux.
Une fermentation anaérobie transforme le tofu en une pâte beurrable. Dans les 胡同 – hútóng de Pékin ou les 弄 lòng de Shanghai, à l’ombre de chapeaux clic-clac de toile blanche, dans de grands woks posés sur des braséros de tôle, des mamies font frire d’épais médaillons de fromage de soja fermentés. L’huile qui y bout est noire à force d’usage. Qu’importe ! C’est si goûteux, entre steack et omelette, si plein de sucs et riche d’arômes ! On repère ce plat populaire de loin à ses suaves pestilences d’excrément frit ! Oh tofu puant 臭豆腐 – chòu dòufu ! nauséabond à souhait comme les égouts de Lahore ! Oh humus bucco-olfactif quand le fétide devient parfum, engendrement croisé du cadavre et du germe, de l’asticot et du phénix !
Ses fragrances font penser au durian, ce gros fruit en forme de ballon de rugby. Carapaçonné comme un triceratops, au nez de lie, de sentine, de fraise, de cloaques de Delhi, de framboise, de banane, de marron glacé, à la pulpe coulant comme un chèvre trop fait, il est le cauchemar des singes qui le guignent mais s’ensanglantent les doigts en tentant sans succès de l’ouvrir. Entre Lille et Gand, sont remugle l’apparente aux fermentations d’une wassingue humide ; en Normandie à Marie Harel et son camembert aux relents de fèces ; entre Vercors et Vivarais il fait penser au nez pointu du foudjou, et partout ailleurs à un organe malpropre.

Aux berges atlantiques, les perfides langues bifides au long nez pâle aiguisent une critique récurrente : le tofu n’a pas de goût ! La belle affaire ! Les patates, les pâtes, le pain, le riz en ont-ils ? Non : ils s’imprègnent des flaveurs de leur assaisonnement ! L’aptitude à se gorger du goût de quoi on l’accompagne, voilà le talent mimétique du tofu !
Pouark ! personne n’aime les chips molles ou le steak caoutchouc. Mais ces fautes d’accord importent peu aux palais de l’Europe. La langue chinoise ne l’entend pas de cette oreille. Pour elle, au contraire, texture et consistance sont des dimensions de l’espace spatio-culinaire, des discriminants du goût que la cuisine explore. Un exemple ? Ce plat si raffiné, si cher, minimaliste, presque conceptuel à la manière des feutres de Beuys ou des pouces de César: sur un bouillon fin bien chaud, on pose quelques feuilles fraîches. Verdure spéciale, d’une lignée sélectionnée par des générations d’horticulteurs chinois – d’où leur prix – pour la qualité unique qu’elles possèdent de fondre gluantes sous la langue. Instant de transe suspendue : quelles délices !
Oui, au rebours des papilles béotiennes d’Occident, les bouches 汉 han explorent la palette du mou, du collant, du ferme, du fibreux, du filandreux, du ligneux, du gélatineux, du flasque, du caoutchouteux, du cartilagineux, du croquant, du craquant, du pâteux, du filant, du granuleux, du velouté, du granité. Ah le cœur moelleux sous la peau croustillante du blond cube de tofu 脆皮豆腐 – cuì pí dòufu. Ah, le satin flasque du tofu de la tante Ma – 麻 婆 豆 腐 – má pó dòu fǔ !
Que la Chine goûte autant goût que texture explique la déception qu’éprouve souvent la bleusaille au long nez novice à la dégustation du Canard de Pékin. Un chef haut entoqué le présente entier à la table dans sa robe caramel (dans les établissements select du moins). Le Blanc imagine que le coq s’apprête à y lever aiguillettes, magrets, dos, filets. Que nenni ! Indifférent à l’art du boucher, le tranchoir tranche, coupe et fracasse à travers la carcasse. Quel dommage ! Dommage quoi ? s’insurge l’Oriental. Pour que chaque museau s’enjoie, ne faut-il pas que chacun ait son lot de tendon, de peau, d’esquilles tout autant que de muscle pour dépiauter patiemment, succulemment chaque espèce de charogne ?

Outre la limace de mer ou la méduse confite, les pattes de poulet sont peut-être ce qui offense le plus le palais des barbares de l’ouest. Crochues, tout de peau, de tendons, de cartilage, d’ongles et d’os, marinées de diverses manières et couleurs – bleues, roses, vertes, jaunes, violettes, mastic – il plait au local de les mâchonner, grignoter, suçoter, machouiller, aspirant, crachant, ensalivant, dans un geste total, impliquant mâchoire et âme, fressure et microbiote. Manducation éminemment sociale quand entre amis, après la ronde des plats, à longueur de soirée on construit la grande muraille – 打长城 – dǎ chángchéng (i.e. jouer au mahjong) – décortiquant sans fin dans les brumes un peu alcoolisées du cocon chinois qui hait la dissonance, des graines de tournesol dont on crache les écorces qui font au sol un matelas. Que deviendront ces écailles tournesoles à des éons d’ici, quand les aura barattées le remuement des continents ?
Tout comme les calcaires sont des cimetières de foraminifères, tout comme les massifs coralliens sont des excrétions de polypes, tout comme la craie est un précipité de lait de chaux sous les rôts carbonés du pullulement biotique, tout comme à Yellowstone des mares à fumerolles nourrissent des glaires de cyano-bactéries, tout comme les flatulences d’archéo-bactéries éructèrent l’oxygène de notre planète bleue, tout comme en Californie s’étalent des plages de cadavres de bouteille: oui ! archéotofu et archéo-fromages en couches d’épaisseur formidables sont le bas-beurre du vivant !
Le géologue du futur dressera demain la carte des strates rouillées de carcasses de bagnoles, de machines à laver, de graines de tournesols. De noirs mineurs frapperont de leurs pics ces résidus de mastication, ces filons de mangeaille feuilletés, triturés, malaxés, tirés, poussés, pliés, cisaillés, cimentés, écrasés, pulvérisés, enfouis, caramélisés, marmorisés, calcinés par la marmite nucléaire, battus par les déferlantes de gabbro, recyclés par la subduction des cratons, secoués par les coups de rein de Gaïa et l’éjaculation des tsunamis. Poussière où tout retourne, rocs brûlants roulant psittacistes sur le tapis du lemniscate !
C’est probablement aux abysses amères sur l’échine des costales que s’allumèrent les premiers fumeurs noirs dont les déjections soufrées rassasient crevettes translucides et crabes à croûte molle. Tout cela n’était, avant que naisse le temps, avant que Chronos ne distillât la panade, que film d’archées dans le bouillon de culture des origines. Tout est fruit de la vie. Gaïa est comestible ! L’anthropocène digère. Alchimie aux arcanes anguleuses, athanor délicat où tout dépend du réglage fin des feux. Incroyable série d’ajustements d’une prodigieuse finesse qui mènent des morves dégoûtantes aux marbres persillés de basalte et aux quinconces de dyke qu’on voit pendre aux parois des Pamirs et des Hymalayas ! Car il a fallu pour que tout cela existât qu’un chameau, avec patience dans l’azur, se faufile par le chas d’une aiguille. Et, si la planète bleue est verte, c’est bien résultat du mijotage à feux plus ou moins doux des résidus de cuisine du vivant !
Voici les faits qu’exhume l’heuristique puissante de cette science disruptive qu’est l’anthropologie gastrotectonique. D’un point de vue méthodologique, la démarche s’impose. Car il suffit ensuite, par rétro-ingénierie, réversion du temps, assaisonnée d une cuillerée d’algorithme du Père Linpinpin – 零频频大爷粉 – de déduire le passé du présent (et inversement), pour espérer enfin décoder la recette de l’archéo-bouillon.
Que constate-t-on alors ?


De troublantes symétries !
A l’ouest pèse le Puy Mary, très ancienne bulle de magma figé dont les baves de basalte et les lahars de cendre édifièrent au long des millénaires ce strato-volcan, omphalos des Arvernes, aux pentes duquel Vercingétorix le rebelle téta le lait chabrot.
A l’est du supercontinent, sur l’autre plateau de la balance Roberval, se trouve un autre strato-volcan : l’énorme mont Paektu, 백두산, la Grande Montagne blanche, 长白山, dont la racine pivot s’enfonce jusqu’au manteau. Un autre dissident naquit sur ses flancs, Kim Il-sung, celui « Qui Transforme le Jour en Or » – 김일성, 金日成 – père de cette dynastie dont le soleil chaque matin espère le lever de paupière pour éclairer le monde à travers sa prunelle.
Le Massif Central est le château d’eau de la France. Chaque jour, il abreuve Marianne de ses fontaines de bouteilles en plastique. Or – coïncidence ? – l’eau et le feu à Paektu s’embrassent. Un lac, le lac Céleste, occupe la caldéra du volcan. Il ne devrait pas se trouver là, expliquent les géologues, si loin de toute subduction. A moins, à moins… que ne gise loin sous la surface, pincé entre moho et manteau, un océan gigantesque, Pacifique et Atlantique réunis. Ses eaux bouent au contact de la forge de Vulcain et ses vapeurs salées percolent les roches encaissantes, les archéo-tofu. Ainsi Paektu est-il comme ces petits pains – 馒头 – qui cuisent à la vapeur dans leur panier de bambou.
N’est-ce encore qu’une coïncidence que protrude en Mer jaune un cap – que dis-je ? – une péninsule, un appendice, le Shandong de granite ? Il est le nez oriental de L’Eurasie comme Blanc Nez et Gris Nez sont les truffes du ponant que mouche l’Atlantique ? Ces deux oblongues capsules ne sont-elles pas tout également de vieilles croupes cristallines ? La célèbre bière Tsingtao – 青岛啤酒 – n’a-t-elle pas la couleur du chouchen ? Quant à la ville de Qingdao, capitale du Shandong, avec ses villas coloniales allemandes, n’évoque-t-elle pas la celte Brest ? Et Maître Kong – Confucius – né natif du Shandong, n’est-il pas à la mode de Bretagne quelque cousin de Merlin ?

Si les ressemblances sont nombreuses et troublantes – tofu, pélardon, picodon sont bien tous trois de couleur jaune-beurré – l’honnêteté critique impose d’aussi noter dissemblances et singularités. Sous Paektu, tofu cuit aux vapeurs salines ; au pays des Arvernes, limon de caséine et de lait de chaux lessivés par la fonte des glaciers !
On le sait : temps et histoire usent l’émail et l’ivoire des dents. Les chryséléphantines ont toutes succombé aux radulas des vrillettes. Ainsi vont parallèles trottant à l’amble manducation et cognition. Ainsi encore pour écrire ces lignes a-t-il fallu d’abord au paléolithique graver de cupules mimant la course des astres des plaquettes de pierre, puis avec Ptolémée, Copernic, décentrer l’univers, faire avec Galilée et Képler un pas cosmique de côté, avant que Poincaré, Einstein, Bohr, Schrödinger, Planck, Dirac – tant d’autres – déplacent provisoirement l’espace-temps à l’angle de la cornée.
Le reste du récit est trop connu pour qu’on le raconte. On se souvient qu’en son temps la découverte, aveuglante d’évidence, passa d’abord inaperçue. Mais un jour, fulgurant dans l’azur de marbre, elle en ébranla les placides piliers. Depuis des études nombreuses et variées – en micro-gravité, sous enclume de diamant, dans l’infra-jaune ou encore l’ultra-rose – ont confirmé la découverte. Reste ce mystère : comment le fade peut-il naître du fort, l’insipide du goûteux ?
Depuis des décennies pourtant s’accumulaient les indices. On s’expliquait mal la formation du fossé rhodanien. On savait le Gondwana principalement constitué d’archéo-caséine, racine commune tant des protéines du lait de soja que du lait de chèvre, tout comme les archées sont mères des eucaryotes. On supputait notre lune résultat d’une collision ancienne entre Gaïa et Théïa, astéroïde libertarien sauvageon parcourant sur son erre ipséïste les molles géométries riemaniennes de l’outremer surréaliste.

Bien plus : les éléments trace décelés dans les échantillons ramenés de notre satellite (caillette, châtaigne, foudjou, bouquet garni) pointaient vers le lieu géographique de la collision, au mitan de la Drôme et de l’Ardèche antédiluviennes : au beau milieu du Gondwana ! On dépêcha derechef aux quatre orients des deux départements des missions d’exploration à grande débauche de pales d’hélicoptère brassant des palanquées de vent. Et l’on finit par identifier un cratère fossile de longtemps enfoui sous les sédiments. Mais surtout, planté à son ourlet, un panonceau confirmant que c’était bien là le centre du Gondwana ! On peut toujours l’y voir à la Baume-Cornillane [2]! Décisive, la preuve était irréfutable.
D’un coup se complétait le puzzle. Par comparaison le petit pas d’Amstrong était un trébuchement. Contre Ariane, contre Apollo, contre Spoutnik, contre l’ESA et ses tombereaux d’euros, contre la NASA et tous les lingots de Fort Knox, c’était là l’exploit à petit budget de deux astronautes free-lance aux caractères bien trempés. Leur fusée à damier rouge et blanc trône désormais au rond point de Chabeuil [3]. Oui, Gaïa et Séléné partagent une même origine fromagère. Wallace et Gromit [4] avaient raison qui pique-niquèrent là-haut à l’aube d’un lever de terre, se délectant de succulents morceaux de lune, rien d’autre que du pur cheddar ! D’un coup se complétait le puzzle. L’ocre des terrains séléniens ? Leur velours grumeleux entre cantal, comté, beaufort ? Cet effluve de farigoule quand on frotte une pierre de lune à la manière de l’ambre ? Bon sang, c’était bien sûr !
Par comparaison le petit pas d’Amstrong était un trébuchement. Contre Ariane, contre Apollo, contre Spoutnik, contre l’ESA et ses tombereaux d’euros, contre la NASA et tous les lingots de Fort Knox, c’était là l’exploit à petit budget de deux astronautes free-lance aux caractères bien trempés. Ils n’eurent pas l’heur douteux de devoir refuser comme Perelman ou Grothendieck l’insulte de clinquantes médailles de vanité: on ne leur proposa pas. Mais d’accord populaire, on érigea leur fusée à damier rouge et blanc au rond point de Chabeuil [3]. Oui, Gaïa et Séléné partagent une même origine fromagère. Wallace et Gromit [4] avaient raison qui pique-niquèrent là-haut à l’aube d’un lever de terre, se délectant de succulents morceaux de lune. Rien d’autre que du pur cheddar ! « Der Mond besteht aus grünem Käse« [5].
[1] Selon certains experts, l’appellation archéo-pélarcodon serait plus adéquate. Débat semblable à un autre : faut-il dire Golfe persique ou Golfe arabique ? Dispute sur le genre des anges – naît-on ange où le devient-on ? – dont débattaient âprement à Topkapi dans la Constantinople assiégée prêtres, docteurs et savants, mages, vizirs, émirs et mirs.
[2] 44°49’24.9″N 5°02’37.7″E
[3] Bien que certaines chartes anciennes attribuent l’engin au mythique héros Tintin
[4] C’est l’aventure de ces deux héros que dépeint le film « La Grande excursion » de Nick Park et Julian Nott (1994), en s’écartant toutefois libéralement de la vérité historique.
[5] « La lune est faite de fromage vert ». Karl Popper, La connaissance objective, Flammarion, Champs-essais, 1998
anarcho-royaliste-anticapitaliste-pro-Trump
Echange de SMS avec un mien ami
– Etienne, Bonjour. Hier vu des copains chrétiens anticapitalistes et aussi pro-Trump.
– Il faudra les présenter à mon copain anarcho-royaliste !
Toutes ces personnes devraient bien s’entendre avec une autre mienne connaissance qui, pleine d’empathie, regrettait amèrement le suicide de cette « pauvre Natacha Rey » qui mit fin à ses jours suite aux persécutions de l’Etat profond pédophile. Natacha Rey est à l’origine de la rumeur selon laquelle Mme Macron serait un monsieur qui aurait trafiqué son acte de naissance.
Quant à la dite connaissance, elle fut naguère présente sur une liste électorale de gauche. Elle est par ailleurs adepte de la secte boudhiste Falungong (法轮功, Pratique de la roue du Dharma), secte que je croisai à plusieurs reprises dans les parcs publics de Shanghai et même lors d’une cérémonie officielle dans cette même ville avant que le PCC n’interdise ce mouvement en raison de son fonctionnement sectaire et de ses liens avec la CIA.
Coquecigrue et tératologie !
Illustration: une coquecigrue en vrai
assèchement du canal de Panama rebattra-t-il les cartes entre Chine et USA ?
L’article qui suit est un commentaire (à quelques corrections mineures près) à l’article « Le Canal de Panama et la présence chinoise en Amérique Latine », paru dans Asialyst dans sa livraison du 16 février 2025.
Quel étrange monde où la physique d’une part (les pommes qui tombent vers le bas, la nécessité) et l’économie, la finance et la politique internationale peuplent des sphères séparées. Car cet article comporte un point aveugle considérable : le canal de Panama connaît d’importantes tensions sur son approvisionnement en eau, et donc sa navigabilité, ce qui a interdit en une occasion au moins le passage des cargos de très fort tonnage. Une pénurie qui n’est pas près de s’arranger et dont les conséquences géopolitiques seront déterminantes. Or, dans ce domaine, la Chine est mieux placée (ou plus exactement moins mal placée) que les USA, pour la raison que le réchauffement climatique est pris à peu près au sérieux du côté de Pékin alors qu’il est nié du côté de Trump.
Les coûts cachés de l’extractivisme (gaz de schiste, minerais, pétrole, bois, eau, etc) qui revient à financer le compte de résultat en mangeant le capital (les stocks) finiront à revenir en boomerang à la face des USA, sous forme de catastrophes naturelles non assurables qui pèseront en retour sur la capacité d’investissement, sur les filets sociaux, sur la potabilité des eaux, ou même la possibilité de leur usage agricole, le tout déstabilisant profondément la société US. La soutenabilité doit être perçue comme une dimension stratégique et non pas « romantique », « hippie » ou « gauchiste ». La Chine, malgré tous ses défauts, l’a compris, peut-être en raison de sa culture de direction collective et « d’esprit de synthèse », cette dernière idée chère au PCC.
Mais de l’autre côté du Pacifique ce sont des idées probablement trop subtiles pour une société fanatiquement éprise d’individualisme et plus encore pour un présentateur télé né coiffé – sans expérience sociale et n’ayant jamais dû se coltiner au réel – et un ingénieur caractériel dont le succès n’est dû qu’au soutien d’un système financier et économique lui-même délirant et n’ayant qu’une parenté de nom avec la démocratie.
Voice of America is dead, vive Radio Free Europe !
« Kirghizistan: le président Sadyr Japarov «soutient» la proposition de Musk de fermer Radio Free Europe *», nous apprend Radio France Internationale ce 11 février 2025. Voilà une excellente proposition. Une fois n’est pas coutume, me voici sur la même position que Vladimir et Jinping. Se pourrait-il d’ailleurs que Vlad et Jinping, qui connaissent le patron de Musk et son intelligence frustre, ait soufflé la proposition au dictateur Kirghize, que Musk s’empresse de bêler en écho ? A Musk, et d’une manière générale à l’esprit insulaire monolithe US, il faut des idées massives, des blocs de concepts , des nuances monochromes, des bons et des mauvais, un monde simple « sinon », comme disait Goering (à moins que ce soit Lénine ou quelque autre du même accabit), « je sors mon révolver ».
Il faut remercier Musk: les idiots sont parfois utiles. En effet, je connais un peu les Pamir et l’Hindoukoush (Turkestan Chinois, territoires du Nord-Pakistan, Inde du Nord). Les populations dans ces zones, autant en raison de la pauvreté de leurs Etats que des directions autoritaires de ces mêmes Etats, s’appuient sur les ondes courtes pour leur information (un poste de radio est difficilement détectable à la différence d’une connexion internet).
Dans l’ordre de leur préférence venait (venait car elle a disparu) en première place la BBC, reconnue pour son indépendance et son professionnalisme. La seconde place était occupée par la Deutsche Welle. Voice of America ne venait qu’en troisième place, en raison de sa partialité. Mais troisième place quand même. La Dame de Fer a rogné les crédits de la BBC qui aujourd’hui ne diffuse plus sur les ondes courtes – ou au moins a drastiquement réduit son temps d’émission – et dont la qualité et le professionnalisme ont nettement baissé: exit le soft power UK ! Merci Margaret.
Qu’Elon Musk n’ait pas inventé l’eau chaude n’est pas une découverte. Mais une telle abyssale bêtise est réellement surprenante. Comment le néo-martien peut-il ignorer le concept de part de voie ? Autrement dit, qu’importe le message, l’important est de saturer l’espace de l’information ? N’a-t-il pas lu les œuvres complètes de Steve Bannon: « Fill the zone with shit ! ». Oeuvres qui tiennent sur un rouleau de PQ et peuvent être lues au WC et utilement recyclées. La propagande a horreur du vide. Laisser un trou dans la toile et bien vite d’autres voies le comblent.
Les USA sont une île. Une grande île mais une île. Et cette île n’a du son succès et son influence mondiales qu’au fait qu’elle a su sortir de ces frontières, commercer avec le plus grand nombre, installer ses troupes un peu partout. Or, Dieu soit béni, le Très haut a donné au monde Trump pour libérer la planète de l’Oncle Sam et de l’emprise du billet vert.
Après Trump et Musk, dans le silence des ondes, personne en Asie centrale, en Asie Pacifique, en Extrême Orient, en Afrique n’aura plus confiance en les Etats Unis d’Amérique. Et d’autant plus qu’aura disparu son parapluie militaire et se sera tarie et son influence économique.
Voilà une place bien chaude que la France et l’Europe doivent s’employer à occuper d’urgence ! La marque Radio Free Europe est en déshérence ! Approprions-nous la ! Merci Musk (et bon voyage vers Mars), merci Trump, merci président Sadyr Japarov ! Vive Radio France internationale, vive Radio Free Europe !
Sur le même sujet, on peut lire: « Pourquoi la Chine savoure le naufrage de l’Amérique de Donald Trump« , publié sur le Site d’Asialyst
- Radio Free Europe, la mal nommée puisque filiale de Voice of America
étalon et dyades
Le paradoxe EPR (Einstein -Podolsky-Rosen) est désormais bien connu. On le nomme également et plus expressivement phénomène d’intrication. Constaté expérimentalement par le brillant expérimentateur Alain Aspect dont les manipulations ont confirmé les inégalités de Bell montrant ainsi la justesse des déductions d’Einstein, Podolsky et Rosen, le paradoxe connaît aujourd’hui des applications dans le domaine de la cryptographie où il permet d’assurer la confidentialité des messages militaires ou des instructions bancaires.
Dans les années 70, me semble-t-il, le phénomène s’étudiait sous un tout autre angle. Des expérimentations auraient alors été conduites – je n’en ai depuis plus jamais entendu parler et ne saurait apprécier l’objectivité de leurs protocoles – sur la réaction d’embryon de poules (des œufs fécondés) aux souffrances infligées à la mère. Les résultats semblaient montrer une relation entre les douleurs de la mère et les réactions de l’œuf embryon.
Ainsi, entre Vietnam et Flower power, l’intrication nourrissait des recherches sur la relation mère enfant, relation incomparable, unique, à l’origine probablement de toutes les relations sociales. A partir des années 80, ces mêmes recherches s’intéressent à la sécurisation des échanges financiers, militaires ou policiers. On mesure la chemin parcouru.
Mais laissons là ces considérations factuelles pour poser une question, ardue et spécialisée, et en même temps banale et simple, dans le sens où elle intéresse l’aperception directe du monde, la sensation et l’intuition.
Les particules intriquées ont d’abord été considérées comme des exceptions, des monstres physiques. Il n’est plus sûr aujourd’hui qu’elles ne constituent pas une partie importante des particules de l’univers. Les particules intriquées, très simples à produire avec un jeu de miroir semi-diffusant, se comportent comme des dyades, c’est à dire comme reflets distincts mais symétriques. D’un reflet sur un miroir, on ne peut supprimer ni l’objet, ni le reflet. Ainsi se comportent les particules intriquées.
Avec un peu de courage, elles nous conduisent à une géométrie vertigineuse de l’univers. Vertigineuse mais probablement, au moins, accessible en partie.
Mais voilà ma question : comment s’articulent le recyclage baryonique – le recyclage des particules assurant le transport d’information dans l’univers, et donc l’exercice des quatre interactions fondamentales – et le paradoxe EPR ?
Rapprochées, les théorie de l’intrication EPR et celle du recyclage baryonique, nous contraignent à admettre que le reflet « intriqué » transporte instantanément à l’autre bout de l’univers une chaîne de causalité allochtone (une chaîne d’interactions aussi « vieilles » que l’univers mais générée « ailleurs »).
Cette chaîne d’interactions venue « d’ailleurs » vient s’insérer, depuis le monde observé (soumis à nos expérimentations) au sein de la chaîne des événements affectant la dyade distante.
Ces deux symétries (dyades) ont, sous l’hypothèse du recyclage baryonique, connu des destins (chaines causales) divergents. Le paradoxe EPR, expérimentalement démontré, nous conduit à l’obligation d’insérer des chaines causales allochtones au sein de chaines causales autochtones, et vice versa.
Cette insertion doit nécessairement se réaliser sans que soit jamais violée la consécutivité, la cause déterminant la conséquence, sans que jamais soit violée la flèche du temps – ce qu’autorise la métrique de Minkowski – ou le second principe de la thermodynamique. Autrement dit, d’un bout à l’autre, alors même que s’y intriquent des consécutivités « locales » et « lointaines », l’univers demeurera localement cohérent à l’observateur, cause et conséquence entrant pour lui toujours dans un rapport de nécessité .
Ainsi si l’on délimite une quelconque portion d’espace-temps contenant au moins une singularité gaussienne, et que l’on dilate, ou contracte infiniment cet espace, je conjecture que l’on obtiendra une distribution de Cauchy. Un tel espace où se conjuguent à la fois paradoxe EPR, recyclage baryonique et transformation des distributions gaussiennes en distributions cauchiennes est d’une puissance métaphysique telle qu’elle remettra en question l’assiette même de nos cultures, pour leur plus grand bien, c’est à dire aujourd’hui pour leur survie.
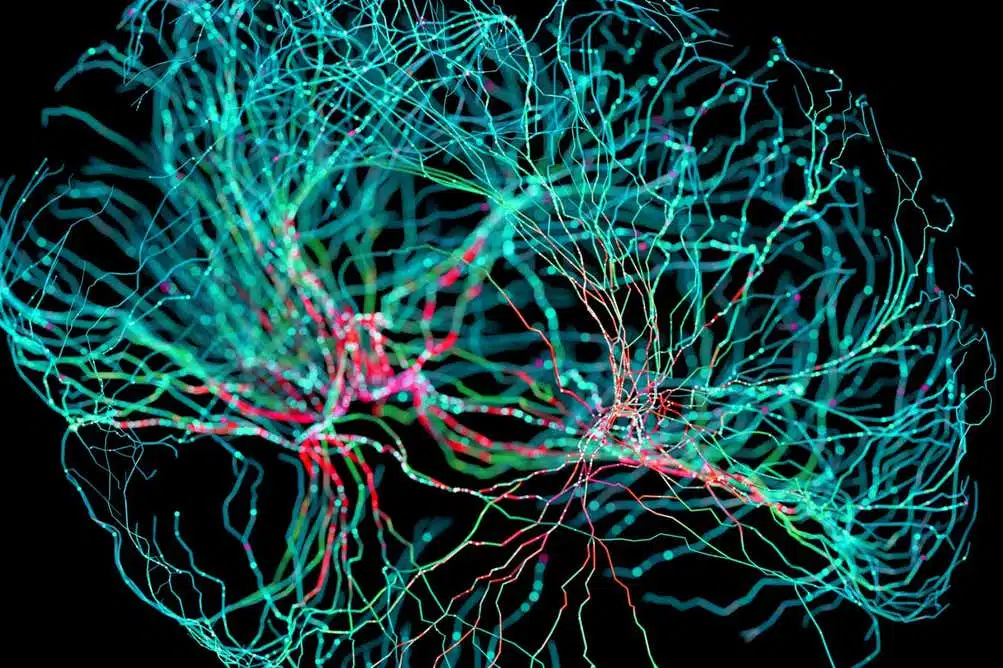
Quelle est la taille de l’univers ? Pour aborder ce point existent de solides points d’appui (Russel, Gödel, Hofstatder, Planck…): quel étalon peut-on trouver pour mesurer l’univers ? Par définition, aucun étalon ne peut être pris en dehors de l’univers. L’étalon donc partage intrinsèquement les mêmes propriétés que l’objet qu’il mesure. Un tel étalon, miroir de ce qu’il mesure, ne peut donc nous apporter aucune information sur la chose mesurée. Il n’y a pas deux objets : un étalon métreur et un univers métré. De sorte que la question de la taille/durée de l’univers ne peut recevoir qu’une réponse tautologique, c’est à dire évidente et infra-discursive.
L’univers n’a d’extension/durée que rapporté à lui-même. Leur valeur est nécessairement l’unité. Dans un tel espace/durée, la paradoxe EPR cesse d’être un paradoxe. Il devient une évidence, construisant probablement, malgré notre aveuglement, l’essentiel de la durée de nos jours, remplis d’instant à déborder, quand nous n’avons l’œil que sur les lignes de fuite, demain, la mort, le lointain, le cosmos.
Crédit photo: https://fr.futuroprossimo.it/2024/08/le-fibre-nervose-nel-cervello-generano-entanglement-quantistico/
Océan Ωxεανούς 太平洋 !
Une rue de la ville de Qingdao – 青岛城市 – dont le caractère européen résulte du fait qu’elle fut une colonie allemande, d’où également la bière du même nom qui ne s’apprécie à ses pleins effluves et goûts qu’en Chine.
Un ami sinophile m’écrit de Bretagne,
notre Shandong 山东 à nous.
Ou plutôt notre ShanXi
山西
notre Ouest montagneux,
Car Gris Nez lèche Océan
au ponant
西
Océan
Ωxεανούς
l’immense fleuve grec
coulant autour des continents
que la Chine nomme
太平洋
le grand fleuve pacifique !
Mon Breton sinophile cite
习近平
Xi Jinping,
l’actuel président chinois
Xí Jìn píng
qui
« S’exerce 习
à approcher 近
la paix 平 ! »
Marrant, non ?
La Corée écrit ses patronymes en caractères chinois.
Le nom du dictateur de la partie Nord,
Kim Jong-un, s’écrit
金正恩 !
Bienfait ou Bienfaiteur 恩
de la rectitude 正
d’or 金 !
Désopilant.
Ou non ?
Illustration: Une rue de la ville de Qingdao – 青岛城市 – dont le caractère européen résulte du fait qu’elle fut une colonie allemande, d’où également la bière du même nom qui ne s’apprécie à ses pleins effluves et goûts qu’en Chine.
faillite morale de la démocratie
Aristote et Platon, tous deux membres de l’élite athénienne, craignaient par dessus tout les promesses de quelque führer ou leader populiste qui entraînerait une population subjuguée vers l’aventure politique, la jacquerie, l’incendie. Telle fut aussi la crainte des pères de la démocratie américaine. La révolution française, fille des Lumières, fit le pari d’une démocratie populaire. Bien qu’initialement restreinte à une élite éclairée bourgeoise remplaçant la noblesse, la condition sine qua non de son maintien et de son avenir était l’élévation continue des esprits de tous et de chacun, avec comme corollaires nécessaires la liberté d’information et de parole, de réunion, de débat.
Mais le terme élite est vague et polysémique : il peut exister des élites morales, des élites marchandes ou financières, des élites militaires. Or du point de vue des élites morales, celle militaires ou commerciales n’en sont point, voire leur antithèse. Ainsi l’Eglise réclamait la paix dominicale, condamnait les exactions du puissant envers le faible, le prêt d’argent: le temps appartient à Dieu seulement.
Aujourd’hui les élites morales, ont été balayées: l’élite commerciale et financière tient le haut du pavé. Ce qui distingue les élites morales des autres est la richesse et l’ampleur de leur culture et conséquemment la relativité de leur point de vue, leur aptitude à voir derrière l’horizon du quotidien ou de la durée d’une vie, leur aptitude à penser contre elles-mêmes.
Or, elles sont aujourd’hui parfaitement discrédités, tenues pour incompétentes dans la sphère pratique, fumeuses, sans contact avec le réel. Seul l’Islam rigoriste souhaite les réhabiliter ou les maintenir.
A l’inverse le capitaine d’industrie est vu comme une forme de héros, même si sa pratique le rapproche plus d’un Mengele. Quant aux élites politiques, leur mode de désignation – électif pour les « démocraties », cooptatif pour les régimes autoritaires (la réalité pratique loin de ces termes polaires étant un mélange des divers ingrédients) – sélectionne les plus avides de pouvoir, ceux ayant prendre une revanche sur la société ou contre leur propre folie: bref, les plus tarés.
Ainsi l’avidité, principal moteur des élites marchandes ou financières, est une forme de régression bien peu propre, tout au contraire, à éclairer les destinées humaines. Voilà pourquoi, dans les arts, en philosophie, ou leurs ersatz contemporains, le médiocre qui sied aux esprits médiocres a bien plus de chance de succès que le talent. Et ce d’autant plus que ce médiocre bénéficie du formidable tambour de résonance des médias de masse peuplés de journalistes falots, appréciant l’éthique à l’aune de leur myopie.
La perspective démocratique a donc connu un retournement complet, puisque l’objectif des élites marchandes (ou technique, la technique étant par trop le bras armé de l’argent) n’est plus du tout l’éclairement de la population, son élévation, mais bien le profit qu’elles peuvent réaliser sur l’exploitation de son abêtissement, l’encouragement systématique de ses travers, tares de comportement et biais de cognition : économie de l’in-attention, temps de cerveau disponible, manipulation de masse des affects, comportements, représentations : ceci ne peut que mener à la catastrophe.
A écouter sur le sujet, en remerciant SLP pour cette pertinente suggestion: Benda « La trahison des clercs », France Inter, 2022
Mayotte, social-racisme et droit des peuples à l’autodétermination
Message à M. le maire de Mamoudzou, Mayotte
Monsieur le Maire,
Suite au message révoltant de M. Le Bras sur France Inter ce matin, doutant que les Français de Mayotte soient des Français authentiques, niant le droit d’un peuple à l’autodétermination et rejoignant ainsi MM Poutine et Xi Jinping dans la négation des droits des peuples ukrainiens ou taïwanais, j’adresse tout mon soutien à la communauté française de Mayotte et dénonce avec vigueur le racisme déguisé en bien-pensance de M. Le Bras et d’une bonne partie de la « gauche » de trahison.
Bien sincèrement,
Etienne Maillet
PS: dans mon indignation, j’ai oublié de citer Donald (pas l’amie de Minnie) aux côtés de Xi Jinping et de son ami Vladimir pour son désir d’annexer le Groenland voire le Canada. Je prie Donald de m’excuser…car il le vaut bien !
ouïr et durer
Qu’est-ce qu’un son ? Qu’est-ce qu’entendre ? Quels longs chemins évolutifs nous ont-ils menés jusqu’à ce point où nous jouissons de la musique dans le pur plaisir du massage vibratoire ? De cette émergence, comment rendre compte dans la plus grande exigence méthodologique, c’est à dire en posant a priori le nombre le plus réduit possible plus d’hypothèses et de catégories, en utilisant le moins d’axiomes ? Pour étudier la question de l’ouïe, nous nous interdirons de juger à rebours. Nous devrons tenter, autant que faire se peut, de feindre ignorer ce qu’est un son, ce qu’est la musique, ce qu’est l’entendement qui l’interprète. Plus glabre la tabula rasa d’où s’élance la question, plus dégagé l’horizon de la conjecture.
Nous nous interdirons de poser a priori, préexistant au stimulus, tout entendement, fût-il seulement un moule neutre et passif. Nous nous interdirons le credo qui ferait de l’entendement une instance préfabriquée qui n’attendrait que l’impression, le stimulus, la sensation pour construire le sens, pour percevoir, comprendre. Nous interdirons de poser à priori les catégories même de l’espace et du temps, de l’avant et de l’après, de la cause et de la conséquence.
Nous admettrons toutefois – car il faut bien admettre quelque chose pour connaître quoi que ce soit, ne serait-ce que le cogito même nimbé de brumes comme chez les animaux – que le sens se forme au contact – de quoi, comment le dire ? – et que de ce contact résultent les phénomènes. Au nombre de ces phénomènes, il faut compter tous les objets, toutes les images, toutes les représentations internes comme externes qui informent ces corps. Représentations en effet, car s’il est vrai que l’univers entier est construit sur la soupe quantique virtuelle, si l’observable entier est un brouet vibratoire, il n’y a ni moyen ni lieu de distinguer l’objet et son image, la matière et l’esprit, le sens et son contenant. Sur quelles bases sensibles assurées devrait-on admettre sans douter la partition des phénomènes en deux espèces a priori distinctes, la matière, et l’esprit ?
Or la matière pourrait-être une fiction sans pour autant nier le réel. Pour le matérialisme, la matière possède une réalité propre, externe. Schopenhauer nomme idéalisme matérialiste cette posture métaphysique a priori. Bien qu’elle traverse de part en part toute la science contemporaine, elle est rarement reconnue pour ce qu’elle est : une hypothèse implicite, aveugle et muette comme l’évidence, c’est à dire arbitraire. Hypothèse qui est de l’ordre du credo, de la foi, de la naturalisation phénoménale comme l’histoire en montre des exemples à foison, telles ces dynasties filles du soleil : le pharaon Akhénaton, fils de Rê, ou Louis XIV, le roi soleil, pour ne citer que ceux-là.
Le réel, à l’inverse, désigne la sensation au contact d’un hors-soi à jamais inconnaissable. Il y a un hors-soi, quelque chose plutôt que rien, stable et résistant. Impossible de le nier. Mais ce réel n’est jamais autrement perçu qu’à sa limite, à sa frontière, à son interface avec un percevant doué de la capacité de se relier au monde. Le type de cette interface est simple : je frappe dix, vingt, trente fois contre le mur et à chaque fois je souffre. La seule chose dont je sois raisonnablement sûr est cette douleur, non pas ce mur, sa forme, sa couleur, sa texture, toutes informations que je n’acquiers que via les sens et l’entendement.
Nous montrerons que quelques forces simples seulement, mais constamment rejouées au cours de la complexification du vivant rendent compte sans mystère du passage de la sensation primitive affectant la bactérie au sens, à la culture, à la musique. Si le monde nous apparaît d’une si stupéfiante et complexe simplicité, c’est seulement qu’à l’instar de l’éphémère ailé, il inonde l’esprit l’instant d’un clin d’œil puis plus rien. Ou bien encore à la manière de la télévision, qui montre des spectacles quand il ne s’agit que du déplacement trop rapide pour être saisi – hors du domaine humain – d’un point lumineux, et quand encore ce spectateur n’a pas étudié la mécanique ondulatoire.
Puisque nous nous astreignons à la frugalité logique, nous devrons construire de manière crédible l’espace, la durée, la causalité que nous ne posons pas à priori. Crédible, c’est à dire conforme à l’expérience, aux résultats expérimentaux reproductibles et en accord global avec les théories scientifiques contemporaines venues de divers cadrans de la connaissance : théories de l’esprit (sciences de la connaissance, neurobiologie), logique naturelle et cybernétique (oscillateurs stochastiques), biologie, éthologie, écologie, anthropologie, physique (relativité générale, mécanique quantique), théorie des nombres, théorie des graphes, fractales, topologie, chaos stochastique, flux et attracteurs, hologramme, théories morales et politiques.
Le futur a rebours

Le jugement à rebours que nous nous efforcerons d’éviter, qui plaque sur le passé les conditions du présent, est un piège redoutable d’une occurrence fréquente. Ainsi en anthropologie, l’homme ancien n’est trop souvent dans l’esprit de ceux qui y songent, qu’un homme moderne ayant vécu longtemps avant le penseur contemporain. Il ne lui manquerait pour être actuel que les connaissances accumulées entre temps: il suffirait de remplir un vase dont la forme est donnée une fois pour toute. Remplissage de connaissances tout extérieures d’un esprit qui subjectivement ne différerait en rien du nôtre
Mais est-on si sûr que les contenants de jadis et d’aujourd’hui sont vraiment les mêmes? L’homme ancien partageait-il avec nous les mêmes catégories, fussent-elles aussi fondamentales, triviales ou évidentes que l’espace, le temps, le passé, le futur ? Ou bien ces catégories ont-elles elles-mêmes une histoire, un développement ?
Si l’esprit n’est qu’un contenant à la forme définitive n’attendant en pure neutralité que d’être rempli, si Athéna naît toute cuirassée du crâne de Jupiter, il faudra alors admettre qu’avant la parole la pensée allait son train selon les mêmes modes qu’aujourd’hui. Et puisque les animaux ne sont pas doués de langage, il faudra également admettre qu’en deçà de leur mutisme, leurs pensers ne diffèrent pas des nôtres. Or si dans une certaine mesure on peut l’accepter des primates, il faudra également par récursion considérer que les catégories subjectives de la limace ne diffèrent pas des nôtres.
Or c’est bien le contraire que présentent avec une évidence croissante les disciplines de la connaissance. Le cortex, cette instance supérieure de la cognition où nous logeons concepts et pensée réflexive, a une histoire comme ont une histoire parallèle et intriquée les réflexes, sensations, émotions, gestes, images. Comment dès lors pensait-on avant le langage ? Comment communiquait-on ? Quelles images se formaient-elles dans l’esprit ? Or si le sens s’applique sur le corps, s’il se confond avec lui, il n’y a plus dès lors de monde extérieur autonome et directement accessible. Il n’y a plus d’outre-là qui contiendrait plus de vérité qu’en-deçà. La perspective est effrayante car elle interdit tout naturalisme, toute vérité extérieure et renvoie directement l’homme à sa solitude ontologique. Et c’est là probablement la raison pour laquelle l’homme préfère rester aveugle à l’idée que n’existe en dehors de lui aucune raison certaine.
L’un des lieux encore où se manifeste avec le plus de vigueur l’illusoire l’interprétation à rebours si lourde d’inconséquences philosophiques, scientifiques et pratiques est le big bang. Non pas les mesures probantes répétées depuis des décennies. Il ne s’agit pas de nier quoi que ce soit des mesures expérimentales. Mais bien de questionner l’interprétation qui en est donnée. La critique interne de la théorie elle-même invalide l’interprétation triviale du big-bang comme origine. La relativité indique en effet que lorsque la densité d’énergie du milieu est extrême – situation qui était celle présidant au big bang à t0+ ε– le temps relatif est extrêmement « ralenti » voire cesse de couler. Or si des durées relatives ne coulent pas ou pratiquement pas, il faut en conclure qu’elles n’ont pas cessé de ne pas couler ou de couler infiniment lentement. C’est proprement ce que dit la théorie : divers temps relatifs coexistent dans l’univers. On ne peut pas ne pas en conclure que ces durées sont coexistantes à notre présent terrestre local et non pas passées comme on l’entend souvent dire. Conséquemment le big bang n’est pas un passé mais bien un actuel. Ou dit autrement, il n’y a pas de durée derrière le mur de Planck.
On ajoute une couche encore d’absurdité interprétative quand prenant le train du temps à l’envers on prétend « voir » l’univers quelques « instants » après le big bang. Or quelques « instants » après le big bang, aucun humain n’existait. Il n’y eut donc jamais de situation dans laquelle un œil vît l’univers en ses balbutiements[1]. Si bien qu’affirmer que l’on aurait saisi quasi photographiquement l’univers en sa gésine – 380 000 ans « après » le big-bang – relève d’une interprétation de mystagogues pataphysiciens aux dessins ultérieurs.
Or la théorie stricto-sensu fait du big-bang l’initiateur de la durée et la condition de possibilité de l’étalon qui la mesure, l’année (qui est rappelons-le une circumambulation terrestre autour du soleil bornée par deux solstices). L’erreur consiste ici à confondre prémisse et dérivée, à expliquer la cause par sa conséquence. Erreur au fond identique à celle par quoi il est souvent affirmé que les lois physiques sont symétriques par retournement du temps : t(L)=-t(L) (où t est le temps, L une loi physique quelconque). Or c’est tout simplement là tomber dans la fiction d’une proposition logique suspendue hors du temps et hors de toute conscience, logique et conscience vivantes et mortelles [2].
La durée et ne saurait être la cause de ce dont elle est conséquence. Nous tenterons dans cet essai de ne pas succomber à l’erreur consistant à penser le passé depuis les cadres mentaux du présent. Tâche ardue et presque impossible tant le langage, naturel, symbolique, mathématique – et l’entendement sont eux-mêmes inextricablement et d’emblée engagés dans la temporalité.
[1] Voir notre texte « Un poil après le futur »
[2] On pourra se référer ici aux considérations d’Alain Connes sur les espaces non commutatifs
Presque rien, moins que tout
Ces bases posées, nous allons au moyen d’une expérience de pensée tenter d’analyser ce qu’est un son et ce mystère par quoi la musique nous enchante.
Imaginons le plus infime des animaux de la plus extrême simplicité : cellule unique, pas même nécessairement eucaryote, peut-être même dépourvue d’enveloppe. De tels organites peuvent aujourd’hui s’observer dans d’infimes diverticules argileux ou des minuscules vacuoles liquides telles qu’en recèlent les glaces polaires ou d’autres micro-milieux. Les connaissances actuelles tendent à y reconnaître de possibles sources de la biosphère.

Image: Protist Paramecium aurelia with contractile vacuoles (source: Wikipedia). La structure ici présentée est déjà extrêmement complexe en comparaison de l’organite imaginaire utilisée dans notre démonstration. Toutefois, au sein de cette structure, les vacuoles contractiles (traits noirs), réagissant à l’équilibre osmotique, ont un comportement proche de cet organite imaginaire.
Simplissime, notre organite peut-être archaïque tout aussi bien que parfaitement contemporain. Nous allons suivre en pensée ses avatars ontologiques. Cet organite n’a au départ pas de compétences. Il est au surplus dénué de tout organe des sens, de tout sens de l’espace et de la durée. Rien ne lui indique qu’il est. Pour cet animalcule, dont la masse est si faible, le milieu cyclique qui le baigne est relativement extrêmement énergétique et puissant. Une simple onde acoustique en modifie la pression interne. Outre cela, il subit un intense pilonnage photonique ; les rayons cosmiques le bombardent ; le flux et le reflux des marées gravitationnelles en barattent les entrailles, tandis qu’alternent obscurité et lumière, canicules et frimas, que changent incessamment salinité, hygrométrie…
Ces influences externes constituent, eu égard à la ténuité de notre ciron, de formidables facteurs perturbateurs. Elles sont, toutes proportions gardées, comparables à l’action de ces grosses planètes capables de malaxer les entrailles de leurs satellites au point d’en fondre les minéraux en magmas éruptifs. Tel est le rapport gigantesque entre l’organite et l’univers. Telles furent, ou plutôt telles sont, les prémisses de la vie. Telles sont et non telles furent, car, on le verra, le passé est nécessairement postérieur au présent.
Donné le gigantisme des rapports entre sujet – notre organite – et objet extérieur (tout le reste), les rapports entre fréquence propres du ciron et fréquences externes incidentes sont des « percepts » presque immédiats. L’extérieur malaxe directement le corps de l’animal. La sensation de « l’extérieur » est ainsi presque directement intuitionnée.
Or le jeu de ces influences – cosmique, stellaire, gravitationnelle, climatique, thermique…- triturant intimement la substance de l’organite, ne peut manquer de déterminer cycliquement des états remarquables selon que les influences incidentes sont en opposition ou bien en conjonction de phase avec la fréquence propre du ciron, amplifiant ou au contraire amortissant tel ou tel phénomène ou réaction métabolique, déterminant polarisations, conjonctions de phases, unissons, points d’orgue, bonaces.
D’emblée se singularisent certains régimes vibratoires : ainsi l’unisson quand intérieur et extérieur résonnent selon une proportion entière, 1,2,3… L’animalcule ainsi probablement déjà « connaît » comme sensation l’octave, le double, dont le type est un rapport de sympathie entre fréquence propre et fréquence du tout environnant quand le corps de l’animalcule vibre en harmonie avec le milieu qui le baigne.
Ainsi quelque sens du rythme et du nombre – la même chose au fond – apparaît ainsi dès la bactérie. Deux sons résonnant à l’unisson, ou bien selon des périodes doubles (à l’octave), manifestent à l’oreille humaine le nombre entier ou réel. La notion intuitive du double – 2 – de la moitié – ½ – est là tout entière en gésine. Voici naissant les nombres entiers, écho des rapports triples, quintuples, septuples… entre fréquence propre de l’organite et fréquence incidente.
Nul besoin donc de présupposer le nombre comme être ou existant, comme idée platonicienne : il est d’abord rapport sensible, intuitionné de deux grandeurs, chacune en elle-même incommensurable.
L’ouïe, fondamentalement, est une « capacité de calcul ». Elle compare un champ vibratoire interne, présent déjà aux niveaux les plus fins et le champ externe, qui s’étend du très proche jusqu’aux confins de l’univers. Toutefois, il ne peut se concevoir qu’aucun hiatus ne sépare l’organite de l’univers. Les rapports entre l’organite et son environnement sont « presque » immédiats, « presque » directs, et d’autant plus que les fréquences propres relatives de l’animalcule et du milieu englobant approchent de l’unisson. Presque : car sans ce « presque », fût-il epsilonesque, l’englobé se confondrait avec l’englobant et ne pourrait constituer un objet. Ce n’est que parce qu’entre l’univers et le percevant se maintient une tension, une différence, un soupçon d’altérité au moins, que le percevant justement se distingue du reste de l’univers. A défaut d’une singularité, il n’y ni percept, ni percevant.
Réduite à l’os, cette différence entre fréquence propre de l’organite et fréquence propre de l’englobant se confond probablement – j’en fais la conjecture – avec la constante de Planck[1], à la fois quantum d’énergie, quantum d’information et durée source.
Ainsi pour l’animalcule déjà une distance se sent, reflet de ses cyclicités propres face aux cyclicités globales ou au contraire fines des « objets » qui l’environnent. Chacune de ces cyclicités est intrinsèquement incommensurable, propre à chaque objet et en marquant l’existence singulière, cet objet fût-il l’univers lui-même. Mais bien qu’intrinsèquement incommensurable chacune en elle-même, leur croisement détermine une durée et un lieu réels, manifestes, et donc la possibilité d’une métrique locale. Cette distance/durée est assimilable à un gradient d’énergie, toujours orienté dans le même sens, de l’extérieur, d’où provient l’énergie, vers l’intérieur, qui la consomme. On nomme généralement ce gradient flèche du temps. A tort, pour la raison que le mot « temps » ne recouvre aucune réalité de l’univers. Seuls s’y distinguent l’instant et la différence élémentaire entre le soi et l’hors-soi.
[1] Quelle est la signification des constantes cosmologiques ? Sont-elles des sortes de « nombres architectes », nombres architectes au nombre nécessairement d’une poignée seulement, et dont les produits architectoniques se verraient au sein des nombres sous forme de nombres « univers », « imaginaires », « premiers », etc. Notons en passant que la dimension de Planck n’adopte ses valeurs bizarres et pas très élégantes – 1,616 × 10-35 mètre, 2,177 × 10−8 kg, 5,391 × 10−44 s ,1,875 × 10−18 C, etc – que parce qu’aperçue, ex-post, depuis ses conséquences, et non depuis son in-ception, nécessairement hors d’atteinte de l’entendement, puisque condition de possibilité de l’aperception. On pourrait bien comme à C, lui accorder la valeur unitaire 1.
Morula

Notre cellule flotte dans l’océan. Au-dessus d’elle tournoie la voûte céleste, s’entrechoquent les galaxies, explosent les supernovae. Des branes cinglent l’univers de part en part en quelques battements, tandis qu’à des niveaux plus fins l’agitation brownienne triture infatigable la soupe de particules bouillonnant et grumèlant depuis le « vide » quantique, instable et gorgé d’énergie. Voilà ce qu’est, pour notre morula, l’univers. Voilà ce qu’il est pour nous aussi, même si de sa réalité profonde nous n’entrevoyons que ce qui est d’emblée utile à notre pérennité phénoménale.
Notre morula ne peut être transparente. Elle est au moins diaphane. Car nécessairement, à quelque niveau, elle transforme la portion d’univers qui l’accueille. Un corps imaginaire, totalement transparent à tous les rayonnements, se laisserait traverser sans altérer le champ incident. Un corps battant à l’unisson de tous les champs vibratoires, n’interagissant aucunement avec son environnement, ne pourrait du fait même de sa parfaite consonance avec ce qui n’est pas lui, développer une quelconque instance de relation avec un extérieur envers lequel il n’entretient aucune différence de potentiel, aucune arythmie, aucune syncope, aucun glissement, aucune solution de continuité. De fait aucune existence, aucune perception ne sont envisageables sans une différence d’avec le milieu, même la plus infime.
Plongé dans un champ vibrant, un corps réagit en adoptant un mode vibratoire particulier, synthèse dynamique du champ incident et des caractéristiques singulières de l’objet. En retour il modifie le champ incident à la manière dont, dans les jardins Zen les ondes de gravier heurtent et contournent les rochers en en soulignant les contours, ou bien encore à la façon dont la pluie solaire aux abords de la terre toronne au sein de la ceinture de Van Allen.
Le décalage entre mode vibratoire propre de l’organite – sa fréquence propre de résonnance – et la mer vibratoire qui l’englobe, fournit la condition de possibilité du développement d’un organe du sens. Cet écart, aussi ténu soit-il, constitue la racine du sens, la condition de possibilité de la construction d’un soi et d’un hors-soi primitifs. La discontinuité du milieu manifeste et délimite la singularité, discontinuité qui est la condition de possibilité de l’émergence d’un organe de relation au monde, d’un organe des sens.
Parler de vibration, c’est interdire l’arrêt. Il n’y a pas de vibration statique, même si localement deux ondes en opposition de phase créent une immobilité virtuelle. Entre l’organite et son environnement circule sans cesse une théorie d’états miroir, par lesquels l’organite ajuste son mode vibratoire aux influences incidentes dans des figures dont le camaïeu complexe – les Moires des vieux Grecs – reflète la structure et les relations entre en-soi et hors-soi. De sorte qu’organite et environnement, en soi et hors soi, intègrent tous deux à chaque instant tous les états de l’univers[1]. Ainsi peut-on dire de la même manière, avec certes quelque approximation, que le mouvement d’une molécule de l’océan reflète et intègre l’ensemble des mouvements de la masse océanique.
Outre un corps, notre organite comporte une limite, une frontière, en deçà de quoi finit l’en-soi, au-delà de quoi commence l’hors-soi. Il n’est pas même nécessaire que cette limite soit matérialisée par une membrane, une enveloppe. Elle peut n’être qu’une solution de continuité en deçà et au-delà de quoi diffèrent nature physique (densité, d’élasticité, comportement dynamique, etc.) ou chimique (salinité, acidité…)
Cette enveloppe, remarquons-le est bidimensionnelle, quand le vitellus est tridimensionnel. Ainsi le régime vibratoire de la limite diffère-t-il nécessairement de celui de la masse de l’organite. Aux modes vibratoires tridimensionnels rétroagis de l’en-soi et de l’hors-soi se superpose le mode vibratoire bidimensionnel de l’enveloppe. De sorte que le sens du « dedans » et du « dehors » émerge du comportement original de la limite. L’embryologie le confirme, qui observe une origine commune au système nerveux (encéphale, moelle épinière, plexus, nerfs) et à la peau, conçue comme un prolongement périphérique du cerveau. Cette peau-limite recèle en puissance les éléments d’une théorie[2] de l’espace, sens dont, par hypothèse, notre organite n’était pas au départ doué.
Vibrer emporte encore une conséquence importante. Vibrer interdit le repos. Le corps de notre organite, incessamment soumis à une myriade d’influences périodiques, n’est jamais quiet.
Ainsi dans le cas d’une onde acoustique, alternance de pression et de relâchement, le corps de notre animalcule se voit alternativement comprimé puis étiré. En sorte que l’état énergétique de notre organite n’est jamais « consécutivement » semblable. Pour le ciron, cela n’est pas sans conséquence : il lui faut réguler continuellement à la fois l’accroissement d’énergie potentielle et sa dissipation. Or il n’est pas interdit de supposer que certains états sont pour notre animalcule plus « confortables » tandis que d’autres le sont moins : plus « confortables » quand le métabolisme de notre organite se trouve amélioré, « inconfortable » quand il se trouve à l’inverse dégradé.
[1] L’étoffe de l’espace-temps est bien cela : une collection infinie de centres où se jouent des espace-temps singuliers, barycentres de l’ensemble des influences externes et de la source interne. L’agrégat synthétique de tous ces barycentres donnent l’illusion d’un espace-temps externe universel, qui n’a pas en soi de réalité.
[2] « Théorie de l’espace » au sens où l’on dit « théorie de l’esprit », dans les deux cas avec abus, puisqu’il ne s’agit pas de théorie à proprement parler – procession logique de concepts rationnels et conscients plus ou moins conformes à l’expérience – mais de théorie implicite et inconsciente par quoi se forment les perceptions, concepts, affects et jugements
Translucence
Notre cellule flotte dans l’océan. Au-dessus d’elle tournoie la voûte céleste, s’entrechoquent les galaxies, explosent les supernovae. Des branes cinglent l’univers de part en part en quelques battements, tandis qu’à des niveaux plus fins l’agitation brownienne triture infatigable la soupe de particules bouillonnant et grumèlant depuis le « vide » quantique, instable et gorgé d’énergie. Voilà ce qu’est, pour notre morula, l’univers. Voilà ce qu’il est pour nous aussi, même si de sa réalité profonde nous n’entrevoyons que ce qui est d’emblée utile à notre pérennité phénoménale.
Notre morula ne peut être transparente. Elle est au moins diaphane. Car nécessairement, à quelque niveau, elle transforme la portion d’univers qui l’accueille. Un corps imaginaire, totalement transparent à tous les rayonnements, se laisserait traverser sans altérer le champ incident. Un corps battant à l’unisson de tous les champs vibratoires, n’interagissant aucunement avec son environnement, ne pourrait du fait même de sa parfaite consonance avec ce qui n’est pas lui, développer une quelconque instance de relation avec un extérieur envers lequel il n’entretient aucune différence de potentiel, aucune arythmie, aucune syncope, aucun glissement, aucune solution de continuité. De fait aucune existence, aucune perception ne sont envisageables sans une différence d’avec le milieu, même la plus infime.
Plongé dans un champ vibrant, un corps réagit en adoptant un mode vibratoire particulier, synthèse dynamique du champ incident et des caractéristiques singulières de l’objet. En retour il modifie le champ incident à la manière dont, dans les jardins Zen les ondes de gravier heurtent et contournent les rochers en en soulignant les contours, ou bien encore à la façon dont la pluie solaire aux abords de la terre toronne au sein de la ceinture de Van Allen.
Le décalage entre mode vibratoire propre de l’organite – sa fréquence propre de résonnance – et la mer vibratoire qui l’englobe, fournit la condition de possibilité du développement d’un organe du sens. Cet écart, aussi ténu soit-il, constitue la racine du sens, la condition de possibilité de la construction d’un soi et d’un hors-soi primitifs. La discontinuité du milieu manifeste et délimite la singularité, discontinuité qui est la condition de possibilité de l’émergence d’un organe de relation au monde, d’un organe des sens.
Parler de vibration, c’est interdire l’arrêt. Il n’y a pas de vibration statique, même si localement deux ondes en opposition de phase créent une immobilité virtuelle. Entre l’organite et son environnement circule sans cesse une théorie d’états miroir, par lesquels l’organite ajuste son mode vibratoire aux influences incidentes dans des figures dont le camaïeu complexe – les Moires des vieux Grecs – reflète la structure et les relations entre en-soi et hors-soi. De sorte qu’organite et environnement, en soi et hors soi, intègrent tous deux à chaque instant tous les états de l’univers[1]. Ainsi peut-on dire de la même manière, avec certes quelque approximation, que le mouvement d’une molécule de l’océan reflète et intègre l’ensemble des mouvements de la masse océanique.
Outre un corps, notre organite comporte une limite, une frontière, en deçà de quoi finit l’en-soi, au-delà de quoi commence l’hors-soi. Il n’est pas même nécessaire que cette limite soit matérialisée par une membrane, une enveloppe. Elle peut n’être qu’une solution de continuité en deçà et au-delà de quoi diffèrent nature physique (densité, d’élasticité, comportement dynamique, etc.) ou chimique (salinité, acidité…)
Cette enveloppe, remarquons-le est bidimensionnelle, quand le vitellus est tridimensionnel. Ainsi le régime vibratoire de la limite diffère-t-il nécessairement de celui de la masse de l’organite. Aux modes vibratoires tridimensionnels rétroagis de l’en-soi et de l’hors-soi se superpose le mode vibratoire bidimensionnel de l’enveloppe. De sorte que le sens du « dedans » et du « dehors » émerge du comportement original de la limite. L’embryologie le confirme, qui observe une origine commune au système nerveux (encéphale, moelle épinière, plexus, nerfs) et à la peau, conçue comme un prolongement périphérique du cerveau. Cette peau-limite recèle en puissance les éléments d’une théorie[2] de l’espace, sens dont, par hypothèse, notre organite n’était pas au départ doué.
Vibrer emporte encore une conséquence importante. Vibrer interdit le repos. Le corps de notre organite, incessamment soumis à une myriade d’influences périodiques, n’est jamais quiet.
Ainsi dans le cas d’une onde acoustique, alternance de pression et de relâchement, le corps de notre animalcule se voit alternativement comprimé puis étiré. En sorte que l’état énergétique de notre organite n’est jamais « consécutivement » semblable. Pour le ciron, cela n’est pas sans conséquence : il lui faut réguler continuellement à la fois l’accroissement d’énergie potentielle et sa dissipation. Or il n’est pas interdit de supposer que certains états sont pour notre animalcule plus « confortables » tandis que d’autres le sont moins : plus « confortables » quand le métabolisme de notre organite se trouve amélioré, « inconfortable » quand il se trouve à l’inverse dégradé.
[1] L’étoffe de l’espace-temps est bien cela : une collection infinie de centres où se jouent des espace-temps singuliers, barycentres de l’ensemble des influences externes et de la source interne. L’agrégat synthétique de tous ces barycentres donnent l’illusion d’un espace-temps externe universel, qui n’a pas en soi de réalité.
[2] « Théorie de l’espace » au sens où l’on dit « théorie de l’esprit », dans les deux cas avec abus, puisqu’il ne s’agit pas de théorie à proprement parler – procession logique de concepts rationnels et conscients plus ou moins conformes à l’expérience – mais de théorie implicite et inconsciente par quoi se forment les perceptions, concepts, affects et jugements
Continuer la lecture de « ouïr et durer »Vendée Globe
Le Vendée Globe Challenge
se court actuellement.
Grâce à des caméras embarquées,
des satellites
constellant l’azur
de leurs chiures,
grâce à des émetteurs,
pleins de coltan
qui assassinent les gorilles
des barres de plutonium
des millions d’heures de travail
harassant
des puces Nvidia
des Amazones d’eau pure
abreuvant des centre de données
gobant des gabegies d’énergie
nous voyons à l’étrave des bateaux profilés
filer l’onde en remous tendus.
Véolia,
Veolia Environnement
fait partie de la course !
Ils triment les beaux navigateurs !
Ils suent.
Ils feront demain la pub pour des
déodorants.
Naguère, Bernard Moitessier refusait la course.
Le monde avait un sens.
mercure
L’air surchauffé vibre sur la plaine sans bords entre Sahel et Sahara.
fondue à blanc l’atmosphère chatoie de langues
mouvantes d’argent vif où s’accolent, s’embrassent,
se délient des flaques de carbone en mouvants miroitements
dessus, flottant entre ciel et horizon
paît une gazelle gracieuse qui hasarde
dans l’eau du mirage un sabot délicat.
Sur le chaudron de photon, sur le magma de lumière dense
pèse un azur solide, sec, pur, dur, plane un bourdon minéral
à peine troublé par les notes indécises d’un luth lointain qu’égrène un plectre.
Là, au milieu de nul part, à l’ombre chiche d’une zériba
posée sur l’arène un douanier s’est assoupi transistor à l’oreille.
Cette cabane de palme, c’est le poste frontière entre Niger et Mali.
Au mitan de ce néant, les vibrations hésitent
entre réel et illusion,
entre ébranlements hertziens d’un lointain muezzin
et la corde de peau et le corps de bois
du djembé et de la derbouka,
de la cora, du luth.
Au centre de ce rien, à la frontière de deux paumes nues
s’affrontent deux devenirs
Dans les madrassas, les corps balancent rythmiquement
les dos ploient aux cinq prières du jour
on rêve d’une vie codifiée sous le regard de Dieu
tandis que les antennes des villes hérissées
d’envies frustrées beuglent leurs publicités
.
Pour ces terres sans confins
l’Islam rêve d’un autre pacte entre l’homme et le divin
entre l’homme et la femme,
entre tumulte du désir et sagesse équanime,
entre l’homme et un Dieu qui
le garderait à distance encore
dans l’attente d’une incarnation
non encore advenue et qui le rend modeste.
A la scansion, à la ritournelle, à la coutume,
les fils des Grecs préfèrent le changement,
le progrès, le temps des engrenages,
le temps cumulé à intérêt, la flèche orientée.
Choc des civilisations heurt des durées
Il n’y a pas dans le clip -parenthèses du temps –
ou les échantillons du rock
dans le halètement des machines
l’espace suffisant pour la lente catalyse
du répons birman, l’égrènement du nan-guan, les ciselures du luth
boustrophédon
La brise marine apporte par bouffées des bribes d’opéra. A un jet d’œil une rizière inondée [1], qu’un buffle au pas grave laboure: son encornure lourde balance lente au rythme de l’effort.
Sur une margelle un transistor est posé. L’araire progresse dans la boue, tirée par le sabot.
A l’ombre d’un cône de paille, les mains sur les conduites de bois, le paysan arpente le boustrophédon du sillon qu’il trace, qui l’éloigne, le rapproche, l’éloigne, le rapproche de la sempiternelle mélopée. Parfois l’haleine saline apporte les vocalises presque humaines qu’égrène un lointain violon à deux cordes. Depuis combien de siècles le paysan pousse-t-il son buffle ? Comme son sillon boustrophédon, l’opéra cantonais revient sans fin sur des thèmes inlassables.
Une fois l’an, sur la place du village[2], une troupe itinérante bâtit son théâtre provisoire, et sous les cintres de bambou prolonge la tradition. Les maisons du bourg s’adossent à la pente, le dos léché par la jungle où errent les pythons, réservoir sans fin d’envahissants cafards, d’iules vermillons et de termites ailés. Dans les vides sanitaires, des cobras chassent les rats.
Devant, le village ouvre vers la mer sur une large aire commune, plane et rectangulaire. De là, la vue embrasse sous un angle très ouvert une pente déclinant mollement vers l’estuaire incandescent sous la pluie de lumière de la Rivière des perles. Dans la brume tropicale presque dense les potagers sont piqués de peluches géantes en guise d’épouvantail : Mickey ici, là-bas, la Panthère rose ! Les rizières miroitantes, l’ocre clair de l’arène piquée de friches rases, les boqueteaux de bananiers aux palmes paresseuses, les plumeaux légers des touffes de bambou où erre le serpent vert que ne craignent pas les chats mais qui les font baver ! s’étalent dans la lumière paresseuse.
Sur l’aire bétonnée, deux panneaux de basket pour les adolescents. Quatre ou cinq échoppes minuscules vendent de la bière et le dépannage du quotidien : huile, nouilles rapides, cigarettes, woks, clous, épingles à linge. Une glacière, quelques tables pour boire la Tsingtao, des parasols, des blocs équarris de tuf volcanique en guise de banc : l’île est une bulle de magma sur laquelle ont vomi des volcans plus récents.
La troupe construit sa scène, haute et couverte, vaste comme une maison. On cloue sur l’armature de bambou des plaques de tôle. Elles brillent sous le soleil dur. Du clinquant, des bannières, des oriflammes, des fanions jaunes flottent, aux caractères noirs, rouges, dorés ou violets balancés par la brise. Tard dans la nuit chaude des projecteurs l’éclairent. Sur le désordre de chaises massé devant la scène, on s’assoit. Les grands-mères apportent leurs travaux d’aiguille ou ramendent une vannerie. On assiste, on écoute, on papote.
Lassé, ou rappelé à la nécessité, on retourne vaquer aux besognes du jour, de la marmaille qui crie pitance, pour revenir le soir au bercement de la psalmodie, tantôt grave, tantôt le cœur battant des joies et des courroux mimés, sursautant soudain aux trilles suraiguës du faux castrat, tandis que se déchaînent le tintamarre aigre des cymbales, que le violon se plaint, que la peau du gong battu fait vibrer l’estomac, que les longues plumes de paon des tiares rejetées d’un coup de nuque fouettent l’espace, qui miment le geste d’un vieil empereur dont les colères, caprices, intuitions animales construisirent le monde, dont on ne sait plus si elles furent géniales ou seulement triviales.
Des jours durant, la représentation se joue, de la fraîcheur relative du matin à la tiédeur revenue longtemps après le crépuscule précoce. Assis de part et d’autres de la scène, en costume ou encore au civil, les acteurs se restaurent. On entame les dômes blancs du riz tassé dans de petits bols de laque rouge, tandis que l’opéra continue, indifférent au friselis des baguettes.
C’est la vie même qui dure et passe, la vie datée et périssable, comme celles plus essentielles, les dits d’annales ou de romans des concubines, des amants, des ducs, pleines de vengeances, de trahisons, d’amours secrètes, de courroux léonins, de guerres, de ruses et de diplomatie. On écoute ou l’on bavarde, on s’assoupit ou bien l’on apprécie, on reste ou l’on s’en va quelques heures pour revenir ensuite finir le jour l’oreille bercée de ces histoires antiques, vieilles comme la culture que tout le monde connaît.
Et l’on n’a rien manqué, car elles ne changent jamais et leurs épisodes s’emboîtent comme les nuits suivent les jours, comme les équinoxes s’enchaînent aux solstices. Sur le fond de l’histoire, le buffle tire l’araire, le paysan la pousse, le sillon se replie. L’opéra disparaît : c’est l’une des dernières troupes foraines de Chine.
arroi, désarroi
Comme ces graines capables de germer
après des millénaires,
la musique invoque en un même présent
un point de capiton
entre des mondes
éloignés dans l’espace, le temps, les subjectivités.
Les protozoaires cillés déjà palpitent d’un rythme propre. A l’oreille du fœtus, le cœur de la mère est la première cymbale,
le premier métronome.
Cadence, contre-cadence, clappe rythmique,
craquètement des bâtons de musique,
une joyeuse troupe préhistorique,
enfants, femmes, nourrissons sur les reins,
frappe l’eau à pleine paume,
poussant le poisson dans la nasse de fibre
premiers rythmes, premiers tempi, premiers chœurs,
équivalent humain des chronicités animales,
des symphonies coassantes,
des vagues stridulantes des cigales,
des concerts perchés des singes alouates,
entre assonance et disonance,
qui ne hurlent pas mais cherchent la musique.
Ces chœurs évoquent dans l’ordre sonore
l’ovulation simultanée
des harem animaux
celle des femmes qui cohabitent
la floraison des bambous partout simultanée
la course parallèle des cerfs en rut
qui en une volte
sublime de synchronie
affrontent leurs ramures.
C’est l’ahan des souqueurs,
contraction et détente alternées,
le répons collectif du souffle à l’arc-boutement des reins sur la houe.
L’animal aussi connaît cette conjonction du labeur et du muscle :
buffle masaï, peuhl, cantonais ou picard à l’arroi,
les yeux mi-clos comme de plaisir ou de méditation,
tandis que le pasteur fredonne sa mélopée et module ses cordes.
Rythme inscrit à la fibre de l’effort et du muscle,
souffle-cri propre à chaque culture,
celui des rameurs abyssins de Montfreid
expirant en cadence.
Danses, rondes, transes accompagnent l’homme
depuis qu’il naît à-lui même,
si lointain héritage qu’il est sans origine.
Longtemps, quand l’homme se nourrissait encore d’effort, de trivial, de sublime,
scurrile et transcendant cohabitaient sous les mêmes calottes de crâne et d’étoiles :
planter, manger, vivre, voir, chanter !
Temps congru à la boucle des jours,
sous la voûte tournante des cieux,
dont le corps est le mètre.
Dans nos villages, sans clocher encore,
le veilleur souffle sa corne pour annoncer l’aube revenue.
Pas d’heures au jour mais des fatigues, des faims, des désirs,
lassitude reposée en mélangeant les corps d’où surgit le futur.
Lors, rien ne saurait éteindre l’épuisement moral de l’homme moderne,
à qui le temps n’appartient plus à force de le compter,
et ne sait plus quel sens a l’existence.
vents du Sud
Le nan-guan – 南 管 , souffle du Sud – est un récitatif monocorde originaire de la province côtière du Fujian, l’antique Min-Yue –闵越- au sud-est de la Chine, rebelle royaume racine de la belle Formose. Sa trace est ancienne, un demi-millénaire avant la naissance du Christ selon notre comput. C’est une musique discrète, mélancolique, élégante, lente, méditative. Une interprète unique parfois dont la voix enlace en chaîne continue, encore et encore, les boucles d’une mélodie linéaire. Sur cette plaine monocorde l’accord surgit, non pas de la synchronie, non pas du rythme, mais de la rémanence des instants, entre sons neufs et sons juste passés. Les notes qui fuient résonnent avec celles qui jaillissent. Passé et présent concordent dans l’oreille.
La Birmanie préserve vivante une tradition lyrique de gracieux répons amoureux : une jeune fille, craignant d’être séduite et redoutant de ne pas plaire sans cesse chante à son soupirant ses refus engageants. Mélopée, paroles, soupirs, nuances s’enlacent, s’enroulent et se délient, toujours reprenant leur danse embrassée. Crainte du rapprochement, de la prise qu’offre le désir à la violence. Sans la crainte surmontée du rapprochement des corps, sans le répons des amants, à quoi servent les parades animales et les codes humains de la cour amoureuse, pas d’étreintes fructueuses, pas d’oreilles pour entendre, pas de musique, pas de temps.
Le nan-guan comme la mélopée birmane tricotent leurs boucles musicales en chaînes continues, récursives, cycliques. Les deux genres renvoient à la lente scansion balancée de la mémorisation orale, à la mélopée, aux généalogies des griots, aux rouelles et svastika scythes, celtes, védiques, au balancement des madrassas, que vient barrer la croix chrétienne fléchée entre origine et fin.
Voici le début…
Voici le début
de la glissade exponentielle
l’été sera celui des incendies.
on aimerait se mettre la tête sous le sable
pour ne pas voir la catastrophe
s’approcher à grands pas
Anxiété
Il fallait cela
la guerre
pour réveiller
les consciences.
Maintenant c’est septembre
l’été n’est pas fini.
L’optimisme s’efface
les vagues s’additionnent,
la suivante chaque fois plus haute.
Charogne des poissons morts.
L’été prochain sera le même,
au carré.
Les fourmis, les blattes survivront
débarrassées des stupides sapiens,
morts au berceau à trois cents mille ans d’âge
de géniale bêtise !
L’anxiété est diffuse et générale, le désespoir enthousiaste
dans la fulguration de tous les angles
que la catastrophe change
Angoisse
Plus de retour possible.
Les humains s’agglomèrent
préparant l’explosion
Leur arrogante confiance les condamne.
Oublier, oublier,
que le monde est perdu
que la seconde flambée sera pire
danser, danser, jusqu’à la chorémanie !
protéodies
L’ouïe n’entend qu’au travers des préjugés et des filtres de la culture, des écumes desquels nous affranchit la musique. Par delà les époques et les identités, elle coud, libre d’époques et de frontières, un point de capiton entre des mondes distants, ressuscite l’ouïe, la voix, les doigts des musiciens morts, y synchronise le vivant dans un commun virtuel présent.
Les protozoaires cillés déjà palpitent d’un rythme propre tandis que le cœur de la mère est le premier métronome cymbalant à l’oreille du foetus. Clappe rythmique, cadence, contre-cadence, claquement des bâtons de musique, halètement du didjeridoo, scène totale du rite ou geste et symbole, bouche et âme, physique et métaphysique, parois de pierre et tétons de calcite, partagent une même substance, tandis qu’approche une joyeuse troupe préhistorique, enfants, femmes, nourrissons dans le dos, battant des paumes l’eau, poussant le poisson dans la nasse de fibre.
Premiers rythmes, premiers tempi, premiers chœurs. Ils sont chez le bipède l’équivalent des chronicités animales, des symphonies coassantes, des vagues orchestrales des cigales orientales. Ils évoquent dans l’ordre sonore l’ovulation simultanée des harems animaux ou des femmes qui cohabitent. C’est la course parallèle des cerfs en rut, qui en une volte sublimement synchrone affrontent leurs ramures.
Le rythme s’inscrit d’abord dans le métabolisme du muscle. C’est le souffle-cri des rameurs abyssins de Montfreid, expirant en cadence ployés sur l’aviron. Chant d’effort inscrit à la racine du corps tout coloré de culture. C’est l’ahan des souqueurs, l’aria des tractions et détentes alternées des bras, épaules et coeur. C’est le répons choral qui soutient l’effort de la houe et l’arc-boutement des reins. Temps métabolique que l’animal à l’arroi, buffle masaï ou peuhl, bœuf picard, au labeur difficile, endure les yeux mi-clos et comme méditant que pousse la mélopée du bouvier traçant le sillon.
Danses, rondes et transes accompagnent l’homme depuis qu’il naît à lui, héritage de si loin qu’on n’y saurait trouver ni terme ni origine. Longtemps, la mystique se nourrit du geste, trivial, poétique, acrobatique, astucieux, laborieux, dont le corps est le mètre, dans la boucle des jours sous la voûte tournante des cieux.
Dans nos villages, encore sans clocher, le veilleur souffle sa corne pour avertir de l’aube revenue. Pas d’heures au jour mais des fatigues, des faims, des désirs, la lassitude du corps demandant sieste et repos. Salubres courbatures de l’histoire immobile quand l’éreintement moral guette l’homme moderne qui ne connaît plus de raisons à ses jours faute d’encore être maître du temps.
sans pâleur ni blessure
A ma peau suspendue tes caresses
et mon cœur tout beurré de tendresse
ému par tes cris de ventre à mon oreille
dont résonnent la forêt ténébreuse
qu’envient alanguis de leurs belles
le cerf bramant ou l’ours réveillé
je vois tes yeux mon cœur la flamme rieuse de ta taille menue
que mes mâles mains ceinturent
allongée désirablement nue
sur un tapis d’air et de lune
Seras-tu toujours cette perle
ce souvenir de génie
sous la voûte d’étoiles
de peau et de caresses
de pompes soyeuses
et de buccales délices
où nous berçâmes enfants
toutes les cosmogonies ?
Mémoires trop serrées pour y songer sans doute
car la droite, l’angle, le calcul président aussi aux couples :
les larmes, les déchirements ruinent même les pyramides
et le crêpe lourd ensevelit les enfants les plus beaux
solitude, force, fierté sont compagnes plus fidèles
qu’amoureuse de chair !
Pour seule promesse alors
un amour provençal aux journées belles
à l’azur si profond que les siècles y stationnent
où des avions d’argent ont des murmures d’insecte
où tes pupilles tracent des rayons légers
amour d’un seul été et de simple gaîté
qu’aucun hiver, oncques froidure
sans pâleur ni blessure ne troublent nos rires clairs !
l’étoile d’ouate
Parti en cocaïne visiter le Sahara ou plus loin
la nuit baillait un jour laiteux
de son sabot ma monture leva
dans une coloquinte lové un scolopendre
du cocon ligneux ennuyé et marri d’être ainsi tancé
le multipode désigna mon nez
instantanément
plus gras et plus brillant
je louchais sur le miroir céreux où brillait
une étoile de cellulose
une fleur d’ouate
à la lumière de diamant
ma mule tanguait sur des croupes de sable
avec comme seul orient entre mes yeux
cette étoile sur mon nez
il me fallait la suivre
je montais, descendais des marches minérales
entre des haies d’yeux blancs suivant ma silhouette
dans des visages noirs
d’autres à mes pieds gisaient
c’est de Sète que je partis
ayant dormi deux jours dans une villa ravagée de la Colline Saint Clair
dont je sautais le porche art-déco
voilà trois pièces
la première au lavis bleu jonchée de gravats
la seconde sanglante rongée de moisissure
dans la troisième les éclats d’un miroir
les chiottes sont couverts de poussière
la pluie à l’aube me tira de mon gîte
tout près, la grande croix de néon
achevait de baver sa laitance blafarde dans le jardin de l’église
Je rencontrai Aïcha qui vit l’étoile sur mon nez
en parla à Malika, celle qui sort avec Esteban
Ils me gavèrent tant de leurs conseils et apories croisées
que n’en pouvant plus je rentrai à Montpellier astiquer l’étoile d’ouate.
flemme
Encore une nuit dans la mort trouée. Il l fait noir, ça pue. Je me suis affalé ce matin avec mes chaussettes. J’entends étouffé le bruit des poubelles métalliques qu’on remue. Cette histoire doit être ancienne, car les poubelles sont désormais en plastic par arrêté municipal.
Quand je me suis réveillé, j’étais assis sur mon lit, les draps bien blancs luisant faiblement. Mon lit était tourné contre le mur, sans que je sache s’il s’agissait d’un exercice Zen ou une d’une punition pour je ne sais quelle faute. Dehors bien qu’il ne plût pas, le paysage était inondé. L’eau mouillait tout, les chaussées, les automobiles, les vélos, les devantures, les passants, sans tomber.
La journée précédente avait été belle, la lumière jouait dans les rideaux jaunes pâles. Je n’avais rien fait, juste regarder les passants autour de la fontaine en bas et les consommateurs aux terrasses des cafés. Ma vue s’attardait sur les cuisses et les poitrines des jolies filles. J’aurais certainement pu en persuader une de grimper sur ce lit. Mais il m’aurait fallu descendre. J’ai donc allumé la télé.
Il s’est mis à pleuvoir, et tout a été balayé, les passants, les terrasses, les parasols, les arbres, tout était trempé d’eau, qui fuyait vive dans les avaloirs, chevauchée par des pirogues de feuilles. Le jour avait fortement décru, comme si on avait éteint la lumière. Mais j’avais toujours mon poste branché.
Je préférais qu’il fasse sombre : après tout cette lumière me dérangeait, et les filles n’avaient qu’à faire aussi un effort. L’esprit du moine Zen doit être tranquille comme la flamme qu’aucun souffle ne trouble. Moi, j’étais plutôt comme le glaïeul ou une autre fleur à tige charnue plantée dans son vase ; tout aussi stable que la flamme, aussi tranquille, je ne pensais pas aux tremblements de terre.
Que m’importait la météo, la bourrasque au dehors, les garçons de café rentrant en hâte leurs fauteuils d’osier : je préférais savoir le temps à New Delhi ou à Pékin sur ma télévision. J’avais de tout façon au réfrigérateur, dans les placards ou les tiroirs ma provision d’intempérie, de vagues, de vents violents et d’éclats de tonnerre, suffisamment de réveils inondés par les fleuves ou les pleurs, suffisamment de bière pour me noyer, d’alcools forts pour sonder les catacombes, de tabac pour imiter la ville (c’est un des principaux avantages de la ville que de priver les gens d‘air).
Dans ces conditions j’avais peu d’énergie pour mes journées. Je restais coi sur mon lit à l’envers aux draps faiblement éclairés. Par la fenêtre, je devinais la cime des arbres, coupée par l’appui vert de la fenêtre. J’imaginais l’écorce noire et humide des branches des arbres de la cour, fichées en terre en quinconce comme des mains figées. Au-delà je voyais les toits d’ardoise pointus de quelque bondieuserie.
Je savais toute la ville immobile. D’ailleurs, elle n’avait pas beaucoup de place entre le ciel bas et sombre et tout ces murs mouillés qui s’arrêtent à la plaine faute de repères : cinq cent mètres après la plaine c’est toujours la plaine. Je m’en souviens comme si c’était hier, mais franchement je n’ai plus le goût d’écouter. Il a tellement plus que ça été dissout. Ce n’est plus qu’une question de temps : ces filles qui pourraient venir ou que je pourrais aller chercher, je m’en fous, comme de ces confidences livrées, ces nirvanas rêvées : je m’en fous. Si désormais, je ne fais plus rien, je mourrai jeune.
L’histoire véridique de l’homme de bronze de la gare de Crest
Il faut parfois raconter l’histoire telle qu’elle s’est déroulée. Sans fard. Sans en rien retrancher, ni ajouter. Sans prêter l’oreille aux racontars.
Non, il n’y a ni cresson, ni glaïeuls. Pas un trou au côté, mais au milieu du corps, une béance énorme. On voit le ciel au travers.
Exécution au canon ? Tir de roquette depuis la gare ? En tout cas, l’impact en plein coffre fut si violent, le métal vaporisé si abondant, que l’homme se figea instantanément dans le bronze. Un éclat du projectile a d’ailleurs cassé l’orteil de marbre du Déporté couché (incident vite réparé).
Qui était cet homme ? Pourquoi une mort si atroce ? Simple voyageur ? Couverture ? Est-il tombé dans un guet-apens ? Des puissances étrangères ? Restons sourds à ces rumeurs.
Mais la valise : que contient-elle ? Quels indices ? Des clous ? Des boulons ? Des gamelles et des bidons ? Des scolopendres, de la scopolamine, de la salsepareille, des scorsonères ? Ou peut-être des cétoines et des situles, des limules et des sousoucs, des cicadelles, des caméleopards suivis de lycaons – ou des paons, ça dépend – des colophons, des tire-comédons, des vers boustrophédon… et, sait-on, des sot-l’y-laisse, des canons à cancrizans, et aussi des marées de syzygie ? Ou bien des sybarites, des stylites, des placomusophiles, ou encore des laies suitées ? Au fait, quelle heure est-il ? Quel temps fait-il dans la valise ? Alice y chute-t-elle ? Et le lapin ?
Mystère !
Attention ! Autour de l’homme de bronze rôde une malédiction : qui tentera d’ouvrir la valise sera changée en statue de sel !
Même si la pluie finira par vous dissoudre, prière aux candidats à l’éternité fongible d’adopter une pose décorative à l’instant fatidique. Car les Crestois auront un temps à supporter votre effigie. Autant être à votre avantage!
éthologie moderne de la girafe
La girafe volante est une espèce fréquente sous nos latitudes bien que rarement aperçue. Tournoyant par troupeau en altitude, son pelage violet la rend peu discernable sur l’outremer de la plupart de nos nuits.
En août, il arrive qu’on repère leurs troupeaux sous forme de grappes d’ombres filant en silence devant l’averse d’étincelles des Céphéides plongeant dans l’anneau lactescent de notre galaxie. Plus rare encore ce spectacle d’une aurore méridionale déployant avec une lenteur magistrale ses draperies chatoyantes que griffe le vol noir des ruminants ailés.
Peut-être ému d’une telle beauté, le pelage de l’animal se met alors à palpiter, virer à l’or, à l’émeraude, au rubis, au saphir, à un diamant si limpide qu’ils font comme des yeux ouverts sur des abîmes d’encre. Oui au ciel la girafe partage avec le calamar et les poulpes au fond des lagons l’aptitude surprenante à montrer ses émotions en palpitant de couleurs !
En rêve on voit parfois le troupeau entier synchroniser ses moirures. Alors à l’œil chanceux advient un singulier phénomène: comme à Montélimar le caramel fige sur les amandes du nougat blanc, l’espace entier se coule dans une forme de marbre. Oh certes elles glissent les girafes mais au fond rien ne se passe !
Les girafes sont friandes de fleurs colorées poussant au sommet de lieux à long panorama : éminences, monts, buttes, mottes. Car comme au flamand rose, leur pitance leur fournit les couleurs. C’est pourquoi elles batifolent en rase-mottes pour gober suffisamment de lucioles, source des photons de la parade amoureuse qu’elles offrent aux nuits d’été. Une seule espèce de pétale leur est toxique : l’orchidée de l’homme pendu (1).
Cette plante affectionne les anciens gibets. Si, comme au-dessus de la croix de Romans (dit « rond-point des Gilets jaunes »), vous habitez près d’un ancien lieu de supplice, alors s’il vous plaît, éradiquez l’orchidée pour préserver la girafe !
C’est un mythe que ces ongulés, comme les martinets, voleraient en dormant. Ou encore que leurs lèvres préhensiles au bout de longs cous au terme de longues pattes jamais ne frôleraient la boue où s’engluent ces étincelles de lumière qui sont l’âme des hommes. Nostalgie de l’étoile !
Sûr à l’inverse qu’elles évitent à tout prix de se poser au fond des vallons. Car dès disparu le dernier rayon de lumière, l’air soudainement refroidi interdit tout essor. Bien lamentable le sort de ce héron – cousin éloigné de la girafe comme le poulet du dinosaure – aperçu un crépuscule d’hiver entre Beaufort et Mirabel pris au piège du puits froid d’un val froid ombreux, condamné à une longue nuit d’anxiété et de périls loin de ses aimés.
Comme certaines pipistrelles, la girafe volante violette est cavernicole (2).
Mais à la différence du héron, qui sommeille vertical, la nuit la girafe en rêve perd consistance. Elle gonfle et flotte libre comme un ballon d’hélium. Sans le plafond d’une grotte, un courant d’air, une bousculade et la voilà évaporée dans l’encre de l’éther ! Aussi les girafes violettes n’ont-elles survécu que sur les planètes à gravité.
Si Newton avait vu une girafe s’envoler plutôt qu’une pomme tomber, que seraient devenus la physique, le monde et tous ses avatars, les quarks, les gluons, les baryons. Nos corps seraient-ils sans pandémies ? Que serait Marck sans Méta ? La terre serait-elle plate, le phénix réveillé de ses cendres, l’unique naîtrait du même, à jamais demain serait comme hier, le vieillard inhumerait le nourrisson, poule et faisan auraient même ramage, esclavage et liberté se contempleraient en miroir ?
A t-on jamais vu un oranger sous le ciel irlandais ? Absurde ! Fieffés fols qui prétendent que les girafes s’hybrideraient aux poissons volants ! Un peu de bon sens, enfin ! Un petit oiseau, un petit poisson…mais comment s’y prendre ?
1 –Orchis anthropophora
2 – Contrairement à sa cousine pourpre.
La caverne et le creux
Ta grand-mère, oh philosophe, n’était-elle pas pythonisse ?
Lentement l’encre nocturne remplace l’azur. Sous la lune qui prend la veille, le marbre luit, poli du frottement des étoffes. En contrebas, sur l’hémicycle, quelques lampes à huile vacillent et dans l’obscurité qui épaissit, projettent dans l’agora des ombres géantes. Les plus grands orateurs ont défilé sous ces sphères, des étrangers célèbres, des devins, des mages, des hyperboréens velus et des Noirs crépus, des Egyptiens, des marchands, des espions et même quelques gymnosophistes venus à grands périls d’au-delà des déserts sur le dos de chameaux à deux bosses.
– « Est raisonnable le raisonnement bien conformé sans schisme logique, qui décrit le réel », clame l’ombre géante d’un index, celui d’un homme peut-être trentenaire aux maxillaires carrés, nets, bien rasé, une fibule d’or à l’épaule. « Les chevaux borgnes ne sont pas chers, mais Athènes pour faire la guerre achète les plus belles cabales. Oui, la logique philosophique, voilà la supériorité d’Athènes… »
– « Tu l’as déjà dit, jeune homme », coupe un vieillard. « Qui confondrait une haridelle et un destrier ? Qui serait sot assez, même sans connaître les signes, pour échanger son or contre une haquenée borgne ? Même pas tes pères, beau jeune homme. Je les ai bien connus. Quand ils avaient leurs jambes, pour vaincre ou rester vivants, ils s’élançaient comme fous derrière l’égide. Comme leurs pères avant eux, ils rejoignaient les montagnes assister aux mystères. Les dieux les chevauchaient comme les autres. Autour de la faille omphalique, tes pères bien mieux que toi comprenaient l’importance de nos cérémonies, quand nous jouions, ensemble, tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, la comédie et le drame de nos vies. N’est-ce pas d’une femme Scythe, il y bien des générations de cela, que provient ton germon ? N’est-ce pas de l’un des Argonautes qu’elle enfanta tes pères ? Elle était parente de Médée, initiée aux cérémonies des hyperboréens, aux mystères qui se jouent sous le dôme enterré dans les vapeurs d’herbe et les effluves du sol ? Ses filles, tes aïeules, n’ont-elle pas visité les mages de Perse, les prêtres d’Egypte ? N’avait-elle pas recueilli les chants des Garamantes, les murmures de Cassiopée, les poèmes de Saba, et ouï dire des hommes singes velus de l’Afrique chevelue ? Ta grand-mère elle-même, jeune homme bien rasé, ne vivait-elle pas dans les grottes de karst, en compagnie des sangliers, dans les collines du Nord où vivaient jadis les Cyclopes, où sont encore vivants les vieux cultes ? N’était-elle pas partie longtemps vers l’Est, au-delà du pays des mages, là où les ascètes adorent un dieu aux mille bras et au collier de crânes ? Ne parlait-elle pas de ces royaumes lointains baignés à ces rivages d’où sort Apollon sur son char, consumés d’interminables guerres dont nous ne savons rien ? On m’a dit qu’une grande couleuvre mâle partageait même son antre. Ta grand-mère, beau philosophe, n’était-elle pas pythonisse ? »
La raison contre les mythes
– « Superstition, tyrannies des mythes ! Nous, philosophes, luttons pour dégager l’entendement de la gangue ancienne de la magie, des cosmogonies archaïques, des royautés enracinées dans le despotisme des mystères. La déduction qu’on fait sur l’hypothèse qu’on avance et que le réel confirme : voilà le credo. Sinon quoi ? Sinon l’émotion, la folie passagère, le démagogue qui flatte la foule, qui l’excite, qui l’enflamme, la lance par la ville forcer les portes des greniers et allumer des feux ? Ou bien préfères-tu, vieil homme, l’archaïque carcan des antiennes magiques, le vieil ordre croulant où vous les chamanes et les rois, vous entendiez si bien pour corseter l’univers et l’homme ?»
– « Les Athéniens en veulent toujours plus », tonitrue une voix forte résonnant d’accents d’airain et de marteau. « Ils ont raison d’être gourmands et ambitieux. Pourquoi ? Parce qu’ils sont raisonnables. Oui, la raison fait la grandeur d’Athènes. La raison est le fondement de sa supériorité politique et morale. Elle l’autorise à revendiquer l’hegemon sur les autres cités. Périclès les fédère pour leur bien. Elles doivent comprendre la beauté, la bonté et le juste d’Athènes.»
– « Elle est belle ta raison. Elle est belle la démocratie », gouaille d’au-delà la margelle, depuis l’ombre violine, une voix au fort accent rempli de borborygmes. « Périclès l’a imposée aux cités fédérées, comme une punition. La démocratie ou l’invasion, la démocratie ou les camps militaires aux portes de la cité ! Périclès a trahi. Le monde nouveau que tu décris est celui d’un début trahi. Mais, je te l’accorde : ce siècle est une première expérience où tout est déjà en germe.»
– « Tant d’hommes de talent rassemblés à Athènes, en si peu de temps, sur si peu d’espace ! » s’emporte un jeune homme maigre à la toge douteuse, à la tignasse de nattes formant masse sous le bonnet de maille. « Est-ce leur génie ? Ou n’est-ce que l’occasion ? Quand la paix règne, quand l’or et l’argent circulent, le plus stupide des colporteurs remplit sa bourse. Génies de pacotille, talents d’occasion, talents factices, talents à la mode ! »
– «Talents sonnants et trébuchants, pour ça oui ! » coupe un homme depuis l’ombre. « Parlons-en des élites ! Socrate, Platon, Aristote, Périclès, Hérodote, Alexandre ? Tous cul et chemise. La même bande. Quelle autre raison plus grande a donc bien ta raison, ô beau philosophe rasé, sinon que de servir les puissants ?»
logique du conte, logique du compte
– « Votre raison », reprend le jeune homme maigre à la tignasse filasse, « c’est la logique du fer : la loi, la norme, la règle, celle que vous gravez à toutes les stèles de pierre plantées aux carrefours. Et même vous l’avez fondue dans le bronze ! Nos pères, les pères de nos pères, préféraient à vos lois la souplesse de la parole, l’accord, l’harmonie.»
– « Ne vois-tu pas que le monde a changé ? » rétorque index encoléré le philosophe aux maxillaires carrés. « Comment les vieilles coutumes pourraient-elles encore répondre aux défis d’aujourd’hui ? Jadis, toi vieillard que mes pères ont connu, tu prenais une barque, tu tournais le cap : les lois avaient changé, les temples abritaient d’autres dieux. C’était il y a longtemps. Les vaisseaux pansus, que protègent nos trirèmes, aujourd’hui nous mènent en quelques jours à Sidon, Tyr, Memphis, Cyrène, Syracuse, à Agathé Tyché ou Massa. Depuis, d’autres dieux ont rejoint dans le temple l’idole poliade. D’hors les murs ont afflué les métèques, les esclaves, les miséreux des collines et des plateaux trop arides, trop peuplés. La puissante Perse menace. Aristote peut bien conseiller l’autarcie. Si Athènes ne s’était pas tournée vers la mer, si Périclès n’avait pas imposé notre démocratie, nous échangerions encore nos sardines sèches contre l’orge plein de cailloux de Lacédémone !»
– « Vous chamanes, chenus ou jeunes, prétendus philosophes et véritables errants, n’êtes qu’une bande d’idéalistes, de rêveurs. Je construis des galères au Pyrhée. Je travaille dur, moi. Je fais commerce avec ceux du Pont. J’ai même, en ce moment peut-être, un navire au-delà des piliers d’Héraclès, parti chercher l’étain. J’importe le blé de Colchide, que vous mangez ici. Le pain de froment, vous en voulez bien, hein ? Mais vous ne voulez pas des règles, des sceaux, des mesures, des étalons pour l’acheter ! Comment sans eux fonctionnerait le commerce, sans des règles reconnues partout et par tous les marchands? Finies les disputes, les comptes et les cargaisons au jugé. Les lois faites sous le sceau de la raison sont bonnes pour le commerce. Athènes a écrit les paroles exactes. Tant mieux pour nous que ce soit elle qui l’ait fait ! »
– « Le sceau de la raison ? » rugit l’homme de l’ombre. « De raison, tu as la bouche pleine, et les bras chargés de plans de machines, de roues à dent, de cages d’écureuil, de poulies, de moufles, de bigues, de chèvres. Tu penses comme un calame, et non pas comme un homme. La belle mécanique ! Les portefaix par centaines que tu as débauchés, mourant de faim au bord des routes, entassés aux faubourgs dans des dolia crevées. Tu préfères tes engrenages aux travailleurs libres ! Même les esclaves pour toi mangent trop encore. Les engrenages ne mangent pas, ne se plaignent pas, ne réclament pas. Ta logique est celle du livre de compte. La voilà ta raison. La raison de ta raison. Ta mécanique est l’outil des patriciens, des trafiquants au grand large, l’outil du pouvoir de ta classe ! »
– « Les engrenages », renchérit le chamane à la tignasse, « conviennent bien aux machines. Mais comment pourraient-ils nous dire pourquoi reviennent les jours, les saisons, les moissons ? Vos articulations logiques sont souples comme les maillons d’une chaîne. Vos mètres et vos péroraisons de parchemin sont cassantes et rigides: on croirait l’insecte, et ses segments de chitine, pliant à peine aux joints. Notre mètre n’a besoin ni de calame, ni de stylet, ni de parchemin : il est en nous. Python seul a la souplesse nécessaire de dire au cœur des hommes les paroles qui cernent le futur. Platon même, quand il est au bout de ses raisons, revient au savoir bien usé, bien sûr, bien mûr des mages, seuls capables de faire leur part aux mystères. En peu de mots leurs bouches disent les mythes dont des mers de signes n’effleurent pas même le sens. Socrate raisonne et n’écrit pas : ses convives banquètent. La nourriture entre par la bouche des convives et la sagesse en sort. Comment pourras-tu jamais démontrer comment les enfants aiment leurs parents ? Crois-tu qu’on peut apprendre dans les livres ce que l’on est soi-même ? Crois-tu que les masques au théâtre, tout à l’heure, ici même, ne raconteront pas nos mystères bien mieux que, le licol sur la nuque, les scribes des rois, leurs nobles, leurs philosophes, leurs régisseurs, leurs marchands, leurs esclaves affranchis ? »
Parler est barbare
– « Tu insultes le savoir, sophiste ! », raille le philosophe carré de la mâchoire. « Tu insultes la science, toi qui la vends, contre argent, comme des carottes, à des marchands grossiers qui n’ont que leurs drachmes à la bouche, celui qu’ils dépensent pour ta rétribution, celui que leurs enfants gagneront grâce à ton verbe maquignon. Avocat parfois, précepteur de gosses de parvenus tantôt, secrétaire ici, rédacteur là, traducteur parfois, au gré de tes embauches : un colporteur n’est pas un philosophe. Oui, l’écriture est le savoir des rois. Oui, ses régisseurs gèrent ses domaines. Oui ses scribes notent l’or, l’argent, les pierres, les trophées, la richesse des citoyens, les contributions des alliés à la beauté d’Athènes. Oui la raison sert les rois, le mérite, la valeur, le beau. Oui, le fort est le maître de la raison ! » »
– « Ta raison te trompe », rétorque l’homme à la toge douteuse, « car si à quelque question qu’on pose, l’univers répondait par l’affirmative ? Se ferait-il que l’on puisse trouver quelque preuve à n’importe quelle conjecture ? Parce que l’étendue limitée des conjectures, infiniment inappropriées à leur objet, fait que toujours existe quelque partie du vrai qui les confirme ? »
– « La parole » continue le vieillard, « n’est pas une loi qu’on grave dans la pierre. Elle est utile. Elle se décide. Elle se plie, elle s’adapte. Nos ancêtres la façonnaient à l’ombre de l’olivier millénaire, martelée longuement comme le forgeron la lame de bronze. Longs conciliabules et braves péroraisons. Et quand les gorges s’asséchaient, quand le souffle collectif chancelait, les aèdes pour le réanimer entonnaient encore les généalogies, les exploits des héros, les épopées anciennes. Sous le dôme à demi-enterré, on racontait les rêves, les angoisses, la torsion des viscères, la peur des esprits et des sorts que jettent les envieux. Alors quelqu’un s’écriait : toi là-bas, pourquoi m’en veux-tu ? Une voix entonnait le chant des symboles qui pansent. La voix partagée soignait les griefs, la colère, l’envie, les jalousies, les complots, les maladies du corps, les maladies de l’esprit enfermé dans le corps, et celles de l’esprit qui contient tous les corps. Toi qui respectes le théâtre qu’on va jouer bientôt ici, ce soir, au milieu de ces bancs, ne sais-tu pas que ses racines puisent au vieux culte ? Ne sais-tu pas que la raison est bien faible pour soigner les maux qui n’ont pas de nom !
– « Les charlatans… », reprend après une pause le vieillard d’une voix assombrie, « les charlatans vendent des potions dont l’efficace réside dans le secret jaloux de leur fabrication et le monopole de leur distribution. Les vrais thérapeutes – leur peau sent la chèvre et non le baume – soignent l’homme en entier. Ils soignent par la parole pour ce qu’on veut bien leur donner. Seule l’évocation, la parole, la musique, l’image vivante, recèlent l’efficace. »
– « Socrate n’a jamais écrit une ligne, sauf pour la liste des courses qu’il donnait à faire à ses esclaves », persifle une voix depuis l’ombre ceignant l’amphithéâtre.
– « Platon lui-même » continue le philosophe filasse à la toge crasseuse, « hésite à confier pleinement au calame les paroles du maître, comme si l’instrument ne suffisait pas à contenir sa pensée. L’élève a ouvert les bondes. Après lui, nous le sentons bien, les scribes le diront sans plus de retenue : parler est barbare. »
Parole d’air, parole de pierre
Mère-des-signes, technique, Athènes, logique, democratie, mythes, raison, pouvoir, superstition, Socrate, Platon, sophiste, oralité, écriture,
– « Mon jeune ami a raison », s’anime le patriarche. « Les scribes n’aiment pas la parole au vol ailé. Ils n’aiment pas l’agora. Ils n’aiment pas les mots qui vont du pair au pair. Ils les veulent serrés, scellés, dans des bibliothèques, indexés, conservés, surveillés, bien gardés. Ils veulent la langue fossile, figée, servile. Bientôt leurs signes deviendront la nourriture unique de l’idée.»
– « Vieux chamane, qui connut mes aïeux, ne comprends-tu pas que les signes de Platon voyagent bien plus loin dans l’histoire, sur les mers et les routes, que les discours qui fuient avec la brise du temps et meurent avec les bouches ? Platon, Aristote surtout, défendent le privilège de la raison d’édifier l’ultime savoir, comme moellon après moellon on érige la muraille. Ecrire, c’est poser. Et sur cette première pierre construire. Bâtir, édifier, plus haut, toujours plus haut, et gagner en puissance. Le papyrus et le calame sont les outils de la raison. Un jour, grâce à eux, ratio et être s’identifieront. Pourquoi refuser de vivre avec ton temps, pourquoi refuser le progrès ? Veux-tu t’en retourner dans la caverne des pythonisses, Vieillard ? »
– « La caverne des Pythonisses est à l’abri de la foudre de Zeus, jeune homme dont j’ai connu le géniteur. L’homme bientôt ploiera sous le joug de sa propre raison. Après Platon, après Aristote, j’en suis sûr, viendra la longue théorie des demi-dieux, des demi-philosophes, des prophètes borgnes, qui diront que l’homme peut égaler le démiurge. Un jour viendra où l’homme se croira l’héritier raisonnable de dieu. Il se croira le maître du drame, quand il ne sera plus au théâtre des simulacres que la marionnette de sa nature. Je te le dis, jeune homme bien rasé: le savoir des scribes n’est qu’un voile de plus sur le visage du vrai. Oui, je le crains, le monde pivote aujourd’hui entre la parole d’air et la parole de pierre.
Certains n’ont que celle-là. Les paroles des modestes, de ceux-là, là haut, assis en dehors du cercle, leurs paroles s’envolent et comptent peu. Les autres font venir de Corinthe des blocs de marbre pour y graver leurs mots et en faire des lois. Ils font de l’agora l’annexe de leurs bibliothèques. La justice de l’olivier n’a besoin que de bouches, non pas de sceaux, non pas d’annales, non pas d’archives, non pas de coffres, non pas de scribes, non pas de secrétaires. Entre les chants des aèdes et les bibliothèques des riches, entre la parole et le stylet, entre la science des signes et le savoir des hommes, oui, le monde pivote comme ces étoiles au-dessus de nos têtes. Ton écriture, philosophe, bâillonnera trop longtemps la bouche des vivants. Vous vous trompez, nobles jeunes gens entogés. Votre jeune savoir n’est que jeune, non pas universel ! Combien de temps fera-t-il illusion : quarante, cent générations ? Les illusions de la raison ne sont pas éternelles. Sous l’écorce de l’arbre, non, l’alliance n’est pas rompue. La césure n’est pas définitive. Sous la croûte, le vieux monde des contes, des palabres, des métaphores qui aident à vivre grouille, vivace. Mais quand les mains des hommes seront brûlées, leurs papyrus réduits en cendre, c’est avec leurs gorges, leurs sanglots, leurs cris, leurs soupirs, leurs murmures, leurs caresses, qu’ils se réconforteront, se reconnaîtront, et décideront, sur l’agora, de leur destin nouveau. Car voilà maintenant ma question : comment déchirer les voiles dont vous recouvrez l’être ? »
coïto ergo sum
« Cogito ergo sum ».
Certes, mais avant de penser, il faut être,
ou plutôt exister.
Selon les grammairiens
« être » est un verbe d’état.
Etre est !
Ne pourrait-il pas l’être ?
De quel état parle-t-on ?
Pour lire ou entendre, il faut qu’oxygène
et glucose alimentent l’entendement.
Il faut que mon cœur ait battu,
le sang circulé
les synapses fulguré
l’univers tourné.
Etre est le mouvement d’exister,
l’appétence à perdurer et se maintenir singulier
dans l’instabilité et le flux
où se dessinent des vortex,
des môles de transiente stabilité,
les figures d’étranges attracteurs
comme des frondes pour propulser
dans le cosmos immense,
le destin des glébeux à la tignasse céleste.
Etre serait un verbe d’état ?
Oxymore ! Le verbe, c’est l’action, le geste,
l’onde qui ébranle le vide : la vie !
Comment l’action pourrait-elle être état ?
Puisqu’il faut naître pour penser,
il faut un coït au cogito.
« Coïto ergo sum »: je copule donc je suis !
tachycardie
Des gueules noires s’étourdissent de bière dans l’atmosphère bleue de fumée et de rock d’un pub de Glasgow. Leurs machines se sont tues, à l’issue de plus d’une année d’une dure grève.
Jadis, ils étaient paysans ou pasteurs, vivant au rythme des éléments et de la course du soleil. Ils poussaient leurs moutons sur les parcours communs – les commons – dont l’institution plonge, avant l’histoire, aux racines du clan. Ils se heurtent bientôt aux clôtures fichées par le baron ou le shérif spoliateurs devenus gentleman farmer.
L’ordre du monde pivote, le clan perd sa vigueur, l’ordre nobiliaire s’affirme. Des galeries plongent sous les tourbes d’Ecosse à la recherche de l’anthracite aux veines qui taraudent de plus en plus profond. Insoucieuse de la marche du soleil, la mine enfourne trois fois nuit et jour sa cargaison bipède pour nourrir de puants hauts fourneaux qui vomissent de vêpres à matines leur bave rougeoyante et noire.

De cette fonte on fait des rails et des roues, cordes et plectres des sonorités modernes, gongs des marteaux-pilon, sillon du diamant dans la houille de vinyle. Des rails balafrent la campagne, chaîne d’une toile qui drainent vers les villes les pasteurs devenus bêtes de fer, réglés par la pointeuse, le tour d’équipe ou l’amende de retard. Les métropoles bientôt tentaculaires stridulent, sonnent, tintent du bruit alternatif des limes, rotatif des tours, trépident du choc des pilons, du halètement asthmatique des locos qui s’éloignent dans une nausée d’escarbilles. Partition de fer et de fonte, hululements de la vapeur, striction suraiguë du sifflet, chuintement des fumées, trépidation térébrante, roulement et saccade, voilà la source de l’accord plaqué du riff tachycardique du rock !
Musique industrielle dans ce pub de Glasgow, où vibre en contrepoint comme un écho d’agonie la cornemuse farouche. Musique de résistance et musique de défaite. Défaite de l’Ecosse. Défaite du temps paysan devant le temps industriel. Défaite des mineurs devant la Dame de fer.
Morte la cornemuse, défunt le flageolet, oubliées les scottish, les rondes, les gigues, les farandoles qui tiennent encore au mai celtique. Les accords se plaquent et les riffs hullulent dans un temps débordant, instantané, saccadé, saturé, épuisé derechef, qu’il faut sans cesse remplir à nouveau, de clip en clip.
Tout est donné dans ce temps bref unique, à prendre, à jouir, de suite, d’urgence, dans l’anxiété de l’irrémédiable fuite de l’instant. Agitation, queues de poisson, klaxon, vitesse et excès, freinage d’urgence, radars, énervements, embouteillages, encombrements, agenda électronique, synchronisation des données, portable, alarmes et notifications, retards, avion raté, fulminations, ulcères et contractures : Chronos dévore même les ducs et les barons du nouvel âge sombre, traders, lawyers et businessmen, auto-esclaves d’un temps qu’ils assèchent à force de le pousser.
Quel changement ! Naguère encore les puissants marquaient une cadence tout autre. Le riche, le noble mesuraient leur aisance à leur désœuvrement. On menait du bout des doigts les dames au menuet. On savourait à petite lampée la ronde des aiguilles sur le cartel de bronze. On préférait les mélodies tranquilles au harcèlement du tympan. A petite foulée, par cols, vaux et forêts, de relais en relais, Jean-Jacques Rousseau, ralliait Genève à Lyon, à pas d’homme, dans un silence qui effraierait le moderne – dans la vallée, où roule lent le Rhône poussant de pesantes gabares, nul poids lourd, nul bolide. En route, Jean-Jacques se fait une amie et partage sa nuit.
danser jusqu’à la chorémanie
Voici le début
de la glissade exponentielle
l’été sera celui des incendies.
on aimerait se mettre la tête sous le sable
pour ne pas voir la catastrophe
s’approcher à grands pas
Anxiété
Il fallait cela
la guerre
pour réveiller
les consciences.
Maintenant c’est septembre
l’été n’est pas fini.
L’optimisme s’efface
les vagues s’additionnent,
la suivante chaque fois plus haute.
Charogne des poissons morts.
L’été prochain sera le même,
au carré.
Les fourmis, les blattes survivront
débarrassées des stupides sapiens,
morts au berceau à trois cents mille ans d’âge
de géniale bêtise !
L’anxiété est diffuse et générale, le désespoir enthousiaste
dans la fulguration de tous les angles
que la catastrophe change
Angoisse
Plus de retour possible.
Les humains s’agglomèrent
préparant l’explosion
Leur arrogante confiance les condamne.
Oublier, oublier,
que le monde est perdu
que la seconde flambée sera pire
danser, danser,
jusqu’à la chorémanie !
A ma peau suspendues tes caresses
A ma peau suspendues tes caresses
et mon cœur tout beurré de tendresse
ému par tes cris de ventre
dont résonne la forêt ténébreuse
qu’envient alanguis de leur belle
le cerf bramant ou l’ours réveillé
je vois tes yeux mon cœur
la flamme rieuse de ta taille menue
que mes mâles mains ceinturent
allongée désirablement nue
sur un tapis d’air et de lune
Seras-tu toujours cette perle
ce souvenir de génie
sous la voûte d’étoiles
de peau et de caresses
de pompes soyeuses
et de buccales délices
où nous berçâmes enfants
toutes les cosmogonies ?
Mémoires trop serrées pour y songer sans doute
car la droite, l’angle, le calcul président aussi aux couples :
les larmes, les déchirements ruinent même les pyramides
et le crêpe lourd ensevelit les enfants les plus beaux
solitude, force, fierté sont compagnes plus fidèles
qu’amoureuse de chair !
Pour seule promesse alors
un amour provençal aux journées belles
à l’azur si profond que les siècles y stationnent
où des avions d’argent ont des murmures d’insecte
où tes pupilles tracent des rayons légers
amour d’un seul été et de simple gaîté
qu’aucun hiver, oncques froidure
sans pâleur ni blessure
ne troublent nos rires clairs !
En bleu de chauffe
En bleu de chauffe j’irai
ravauder cordages et filets
je laisserai ma lance
et oyant le tango
je trierai maquereaux et mérous
desserrerai l’étreinte trucide
des étoiles sur les coques
à marée basse
dans de petites flaques
je cueillerai les vers
poilus ou annelés
pour les offrir à la brune venue
à la blonde choisie
à marée basse
les crabes roulent comme des larmes
sur les rides des vieilles femmes
nous ferons le tour de leurs coiffes en tandem
nous les amidonnerons de nos semences
qu’elles rient, qu’elles rient les débris
qu’elles montrent leurs râteliers jaunis
et toute la sombre
végétation de leurs gorges affaissées
En tandem cul et selle
nous jetterons à poignée
au soleil le sel des marais
que de pousses, que de pousses vertes
de grasse salicorne !